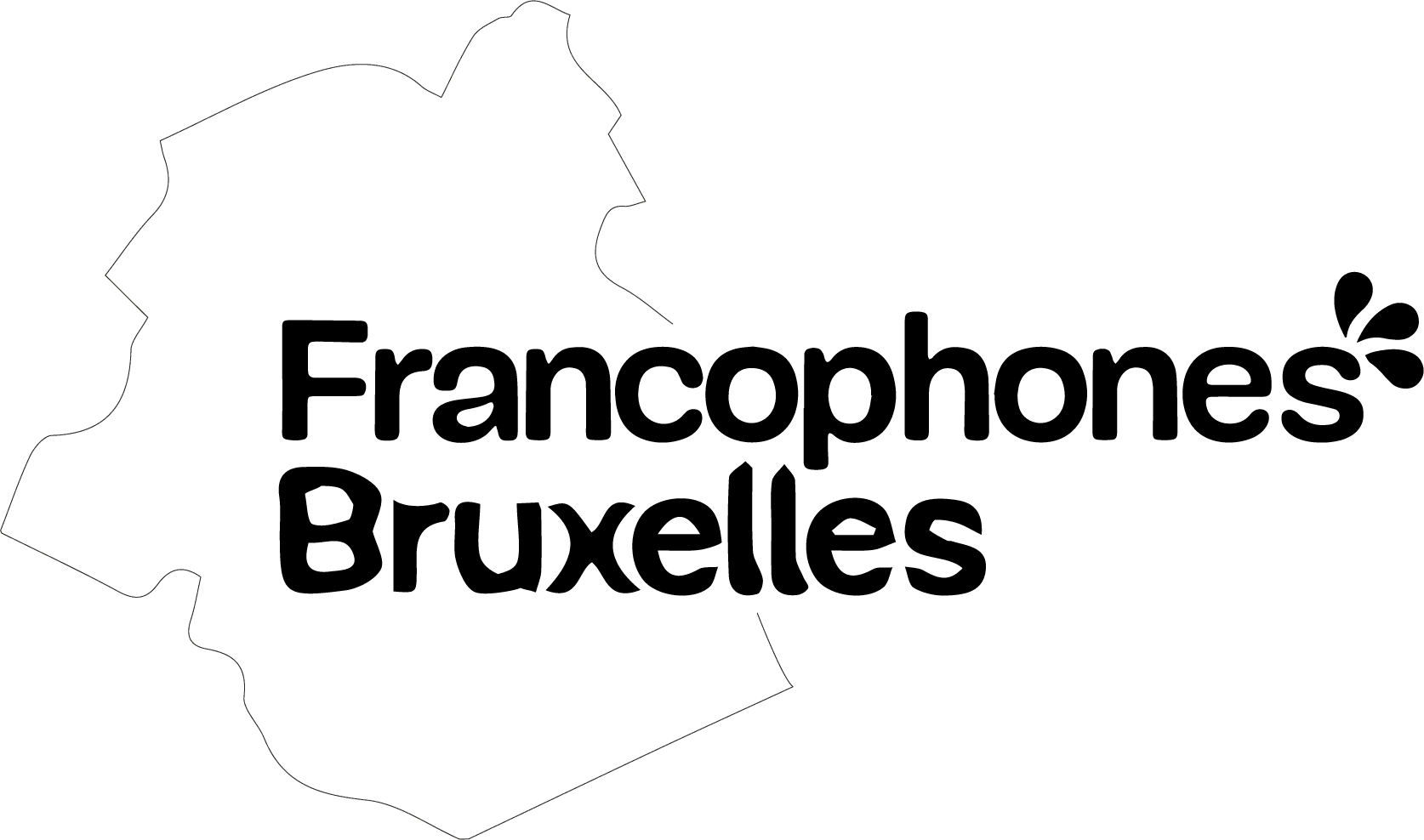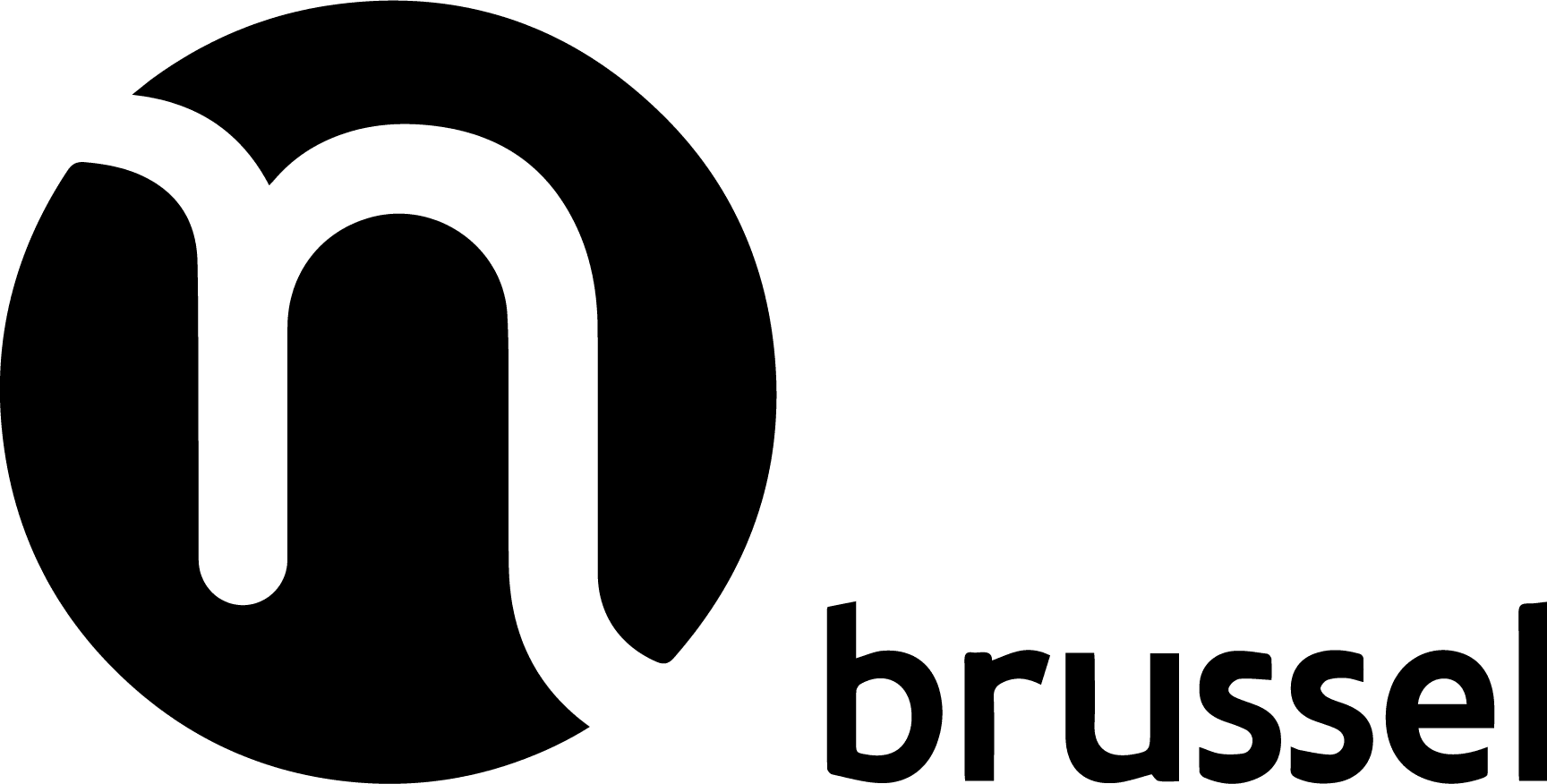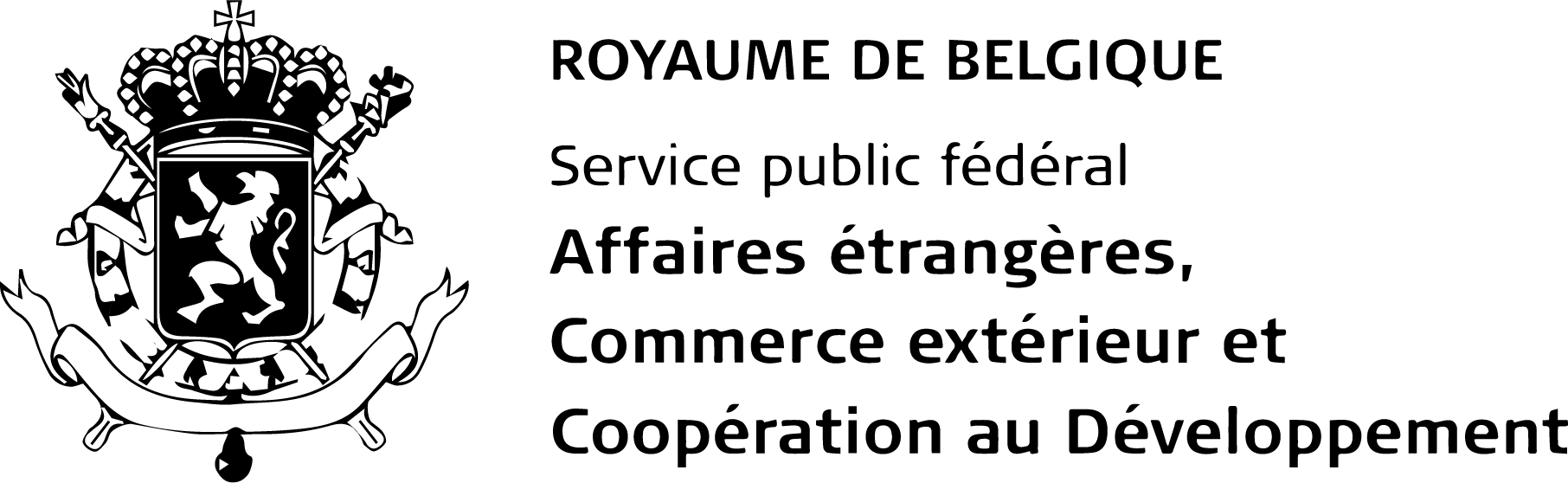Nanna Heitmann est une photographe russo-allemande actuellement basée à Moscou. Elle a travaillé avec des médias internationaux tels que TIME Magazine, The Washington Post ou encore M Le Magazine du Monde. Ses photoreportages lui ont valu de nombreux prix : en 2019, elle a notamment reçu le prix Leica Oskar Barnack Newcomer Award pour Hiding from Baba Yaga.
Les temps évoluent, la vague metoo a déferlé sur le monde, la parité avance doucement mais sûrement, dans une grande partie des secteurs. Cependant certains restent encore à la marge de ce mouvement, notamment dans le monde du photojournalisme qui reste un univers largement masculin. Trop de rédactions ont encore parfois des réticences à envoyer une femme couvrir les conflits sur des terrains de guerre particulièrement violents.
Faisons parler les chiffres : même si les femmes représentent 66% des étudiants en écoles de photographie, sur 697 cartes de presse attribuées en 2017 en France, seules 97 concernaient les femmes photographes.
Une agence telle que Magnum a dénombré, depuis sa création, 14 femmes sur 95 photographes.
Cela n’a pas empêché certaines femmes photojournalistes, à l’instar de Véronique de Viguerie ou Paula Bronstein de devenir des références internationales dans leur profession avec les travaux au Yémen ou encore en Afghanistan mais le chemin vers une égale reconnaissance reste encore en partie à parcourir.
Cherchant à apporter sa petite contribution, Géopolis a souhaité mettre à l’honneur le travail de 10 femmes photojournalistes dans le cadre de cette revue-exposition.
Avec le soutien de visit.brussels et de la Région Bruxelles-Capitale
Europe
Gone from the window
La dernière mine de la Ruhr (2017-2018)
PHOTOGRAPHIES DE NANNA HEITMANN
En 2018, Prosper Haniel, la dernière carrière allemande ferme ses portes, emportant avec elle les vestiges de la révolution industrielle allemande. L’exploitation du charbon a contribué au “Wirtschaftswunder”, essor économique important qui avait permis à l’Allemagne de se redresser après la débâcle de la Seconde Guerre mondiale. La phase de transition énergétique entamée par l’Allemagne a bouleversé le visage de la Ruhr en apportant aux habitants une nouvelle qualité de vie loin de la grisaille qui accompagne l’industrie de l’acier et du charbon. Cette série illustre la difficulté du métier a marqué les corps du “club des ouvriers de la dernière mine”, pour certains une silicose maligne s’est développée. Elle a emporté avec elle des mineurs qu’on dit “gone from the window”. Malgré la tristesse des adieux, les mineurs de Prosper Haniel éprouvent de la mélancolie pour cette période et tentent de préserver l’identité si spéciale de la région.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’exploitation du charbon a permis à l’Allemagne de se relever et a contribué au Wirtschaftswunder, cette forte croissance économique qui a nourri le développement d’importants groupes industriels. Mais en 2018, Prosper Haniel, la dernière mine a fermé ses portes.
Il fut un temps où les mines de charbon attiraient un grand nombre de travailleurs en provenance de toute l’Allemagne mais aussi de Turquie, de Grèce ou de Pologne, partageant l’espoir d’une vie meilleure. Le travail dans la poussière et la crasse quotidienne est compensé par d’indéniables avantages matériels : piscines des cités ouvrières, jardins familiaux bien entretenus…. Aujourd’hui, la “garde d’honneur”, le club des ouvriers de la dernière mine Prosper Haniel, entretient le souvenir et les traditions minières révolues.
Les anciens sont marqués par des années de dur labeur : genoux cassés, hernies discales et poumons noircis sont les symptômes les plus typiques. Dans les cas les plus graves, la poussière de charbon inhalée a provoqué une silicose maligne. Heureusement, cette maladie autrefois très répandue parmi les mineurs se fait désormais plus rare. Les souvenirs des anciens se confrontent à une réalité aujourd’hui très différente de celle qu’ils ont connue jadis.
Amériques
Blurred in Despair
Flou dans le désespoir
PHOTOGRAPHIES DE FABIOLOA FERRERO
En raison d’une crise politique sans précédent dans son histoire moderne, le Venezuela est depuis 2018 embourbé dans un engrenage violent. En cause, la réélection de Nicolas Maduro – fils spirituel d’Hugo Chavez – contestée par son adversaire Joan Guaido, soutenu par l’Union Européenne et les Etats-Unis. La montée des violences a entraîné une situation catastrophique pour la population : dévaluation de la monnaie locale, forte inflation, crise sanitaire, hausse du taux d’homicide. Face à ces conditions, des milliers de citoyens vénézuéliens se sont réfugiés en Colombie et au Pérou. “Blurred in Despair” est une immersion totale dans le quotidien suffocant d’une population vénézuélienne fragilisée, appauvrie et affamée, prise en otage par les forces politiques du pays.
Le Venezuela, qui était encore – il y a peu, en 2001 – le plus riche pays d’Amérique du Sud se débat aujourd’hui dans une situation catastrophique, marquée par un désastre économique et sanitaire. Chaque habitant y aurait, en moyenne, perdu 8 kilos. La nourriture, même l’eau et électricité sont devenues des denrées de plus en plus rares au fil des dernières années. La monnaie a perdu presque toute sa valeur en raison d’une inflation d’une ampleur insensée (on parle de près d’un million de % en 2019).
Cette situation a poussé près de 10% de la population à fuir dans les pays voisins et a entraîné une situation sanitaire de plus en plus tragique alors que le pays manque aussi de médicaments. Sur cette toile de fond se joue une crise politique aiguë entre deux pouvoirs qui se réclament chacun de la légitimité populaire. D’un côté Nicolas Maduro, qui a succédé à Hugo Chavez en 2013 et dont la réélection de justesse en 2018 a été largement remise en cause. Un président qui annonce décrets sur décrets et qui a placé les militaires à tous les postes clés sans parvenir à juguler l’immense crise qui ravage le pays. De l’autre Juan Guaido, président d’un parlement quasiment vidé de tous ses pouvoirs par le régime, qui s’est autoproclamé président légitime et a été reconnu par une cinquantaine de pays à travers le monde.
Cette situation politique résonne bien au-delà des frontières du pays, notamment en Colombie et au Pérou, tous deux confrontés à l’afflux, parfois difficilement gérable, de migrants vénézuéliens. Mais cette crise retentit plus largement dans le monde, divisant largement la communauté internationale avec d’un côté des soutiens tenaces du régime qui vont même jusqu’à lui fournir un soutien militaire – Russie au premier chef – et un camp occidental – emmené par les Etats-Unis et l’UE – qui a pris fait et cause pour l’opposition.
“Flou dans le désespoir” est un projet au long cours réalisé par Fabiola Ferrero qui documente les conséquences psychologiques de la grave crise que traverse depuis des années le Venezuela. Au-delà des tragiques statistiques qui mettent en évidence une inflation délirante, le manque de médicaments et un taux d’homicides très important, c’est le pays tout entier qui semble être entré en dépression. De fait, la santé mentale des Vénézuéliens est compromise par l’exposition constante à la violence et à des circonstances extrêmes. Ce pays coloré des Caraïbes a désormais l’air gris et sa population demeure dans une constante incertitude quant à son avenir.
Fabiola Ferrero, née à Caracas en 1991, est journaliste et photographe, actuellement basée au Chili. Son travail se focalise sur l’Amérique Latine ; son enfance au Venezuela la pousse à travailler sur des sociétés en proie à la violence afin de saisir les transformations subies par la condition humaine. Fabiola Ferrero a collaboré avec des médias du monde entier tels que le TIME, la BBC ou encore El Pais.
Fading into the blue
PHOTOGRAPHIES DE SANDRA MEHL
Dans une Amérique dirigée par Donald Trump, climato-sceptique de la première heure, l’île de Jean-Charles en Nouvelle-Orléans subit les changements climatiques de plein fouet. Chaque année, l’île perd de sa superficie, faisant de ses habitants les premiers réfugiés climatiques des Etats-Unis. Face à la montée des eaux et l’érosion côtière, la photographe Sandra Mehl nous livre leur quotidien dans une région éphémère destinée à disparaître d’ici cinquante ans.
A 130 kilomètres au sud de la Nouvelle Orléans, l’île de Jean-Charles sombre peu à peu. Aujourd’hui réduite à 3 kilomètres de long, elle est reliée au continent par une unique route, et à perdu 98% de sa surface depuis 1955. On estime qu’elle aura disparu dans 50 ans. En cause : la montée des eaux, l’érosion côtière, et l’exploitation pétrolière en Louisiane, 4e état producteur de brut des Etats-Unis.
Ses habitants, moins d’une centaine aujourd’hui, sont considérés comme les premiers réfugiés climatiques officiels des Etats-Unis. En 2016, ils ont en effet perçu 48 millions de dollars de l’Etat fédéral américain pour se relocaliser vers des terres plus pérennes.
Comme l’île de Jean-Charles, la Louisiane, qui concentre 40% des zones humides des Etats-Unis, est en train de couler. Chaque heure, c’est l’équivalent d’un terrain de foot qui se perd, dans cette zone où la disparition des terres est l’une des plus rapides au monde. Dans un pays dont le Président continue de professer des positions totalement climato-sceptiques.
Diplômée de Sciences Po Paris et de l’EHESS en sociologie, Sandra Mehl travaille dans l’humanitaire et le développement urbain avant de se consacrer à partir de 2009 à la photographie documentaire. Pratique qu’elle lie avec ses expériences passées puisqu’elle explore au travers de ses reportages la relation qu’entretiennent les hommes avec leur environnement. Depuis un premier travail dédié à une plage au sud de France déployé sur cinq étés, Sandra Mehl construit ses projets sur un temps long. En 2016, elle documente pendant deux ans le quotidien de deux soeurs de la cité Gély à Montpellier et est récompensée, entre autre, du Prix du festival MAP de Toulouse. Fading into the blue est son dernier reportage en date.
Militer dans l’illégalité
Le conflit avec les FARC en Colombie a duré plus de 50 ans. Une période durant laquelle l’exguérilla a vécu avec le soutien d’une partie de la population colombienne. Parfois, dans le plus grand des secrets.
ARTICLE : EVA SEKER
PHOTOGRAPHIES : MAËLLE REY ET EVA SEKER
En 2018, Maëlle Rey et Eva Seker ont réalisé un long reportage sur la réinsertion des anciens combattants des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), « Désarmés, la réinsertion des FARC dans la société colombienne. » Le pays fêtait, en novembre dernier, le troisième anniversaire de l’Accord de paix historique, signé avec la guérilla, après 52 ans de guerre civile. Cependant, cet accord n’a apporté la paix que de façon superficielle. En effet, les conflits persistent encore aujourd’hui entre le gouvernement colombien, les groupes paramilitaires d’extrême-droite et, entre autres, l’Armée de libération nationale, l’ELN. De plus, une dissidence des FARC a vu le jour à la fin de l’été 2019, lorsqu’Ivan Marquez, ancien négociateur pour l’Accord de paix du côté des FARC a annoncé son choix de reprendre les armes, considérant que l’État colombien n’avait pas respecté sa part du contrat. Depuis la signature de l’Accord de paix, il est vrai que de très nombreux leaders sociaux et défenseurs des droits humains ont été assassinés dans le pays et c’est également le cas d’anciens combattants du groupe armé, qui font souvent l’objet de menaces de mort. Dans cet article, Eva Seker raconte l’organisation, en temps de guerre, du soutien apporté par certains civils à la guérilla.
L’Accord de paix signé en novembre 2016 entre l’ancienne guérilla des FARC et le gouvernement de Juan Manuel Santos a officiellement mis fin à 52 ans de guerre en Colombie. Si l’on sait que le parti politique né de cet accord n’a pas réussi à se faire accepter par tous les Colombiens, on pense moins souvent au fait que, pour survivre à autant d’années dans l’illégalité, le groupe armé a été soutenu par une partie de la population, dans les villes et les villages du pays. Pablo est l’un de ces anciens collaborateurs au sein de la structure urbaine Martín Caballero, à Bogotá. Il a passé 17 ans à militer secrètement pour la guérilla, 19 au total, si l’on compte les deux années de paix qui viennent de s’écouler. « Les fonctions que nous avons remplies étaient un soutien aux compagnons qui venaient des zones de conflits ou de la montagne, et un support de renseignement pour les événements qui se passaient à Bogotá ».
Comme de nombreux militants issus des villes, c’est pendant ses études que Pablo s’est rendu compte de sa tendance politique « bien de gauche ». Ces idées, il les a approfondies en travaillant avec la Jeunesse communiste dans la capitale. C’est d’ailleurs là qu’il est entré pour la première fois en contact avec la guérilla. « J’ai découvert leur travail et leurs idéaux et je me suis retrouvé dans leurs idées », raconte-t-il. « Ils ont commencé à nous proposer à chacun de petites tâches. Nos fonctions étaient majoritairement opérationnelles, de renseignement, du style : Ne passez pas par ici, il y a beaucoup de policiers dans ce quartier. On leur trouvait des faux papiers d’identité, des lieux où ils pouvaient se loger le temps qu’ils devaient rester en ville. Ce qu’on apportait c’était un soutien logistique ».
Les idéaux de l’ancienne guérilla, qui ont tant séduit Pablo, sont d’après lui toujours les mêmes. « Ce que nous voulons, c’est arriver au pouvoir et proposer au pays une nouvelle façon de vivre, un nouveau gouvernement ». Pour Pablo, la politique en Colombie tourne en rond. « Cela fait près de 200 ans que ce sont les deux mêmes familles politiques qui sont au pouvoir : les libéraux et les conservateurs. Ce que nous voulons c’est une Colombie pour les pauvres, pour ceux qui sont les plus défavorisés. C’est la raison pour laquelle nous avons négocié pour avoir des représentants au Sénat et à la Chambre ».
Je ne voulais pas qu’on me ramène à ma famille dans un sac noir en leur disant : votre fils était un guérillero
Militer sans prendre les armes
Pablo voulait soutenir la guérilla mais prendre les armes lui semblait impossible. « Il y a eu plusieurs raisons qui ont fait que je ne l’ai pas fait. J’avais ma carrière professionnelle en tête et je savais que si je partais, je ne pourrais jamais faire ce que je voulais par la suite. Mais je ne l’ai surtout pas fait par peur ». S’en aller pour la montagne, rejoindre les guérilleros, signifie prendre le risque d’y laisser la vie lors d’un combat avec l’armée ou les paramilitaires. « Je ne voulais pas qu’on me ramène à ma famille dans un sac noir en leur disant : votre fils était un guérillero ». La famille de Pablo ne soutient en rien la guérilla. Issu de la classe moyenne, il a toujours vécu dans un milieu conservateur. « Ils considèrent que les gouvernements sont les seuls à décider, et c’est tout. Je ne suis pas d’accord avec eux. J’ai une vision d’inclusion sociale différente ». Pablo a caché à ses proches son appartenance à la guérilla pendant 17 ans. Ce n’est qu’au moment du lancement du parti, début septembre 2017, qu’il leur a raconté son histoire. « Ce fut un choc pour eux. Surtout pour mon père, qui a été séquestré par les FARC pendant deux mois. Et pour ça il les déteste. Pour lui, c’est incompréhensible que je puisse encore soutenir des gens qui nous ont fait tant de mal ». Quand son père s’est fait capturer par la groupe armé, Pablo n’a rien su faire. « Je me suis senti trahi par mon groupe ». Pablo qui faisait partie d’une structure urbaine, n’avait aucune prise sur la situation, puisqu’il n’avait pas de contact direct avec la guérilla. « Mon père a été libéré par l’armée et la police colombiennes après un combat dans la zone dans laquelle il était séquestré. C’était sous le gouvernement d’Alvaro Uribe. Et mon père, s’il l’appréciait avant, aujourd’hui, il l’adore de toute son âme et il pourrait donner sa vie à cet homme ».
Malgré ses peurs, Pablo et les autres miliciens urbains ont dû suivre une formation militaire. « C’était au cas où. Dans la guérilla, il y avait deux types d’enseignement : le militaire et le politique, et nous devions aussi nous former à l’enseignement militaire, pour si un jour il fallait qu’on se batte. C’était un peu comme une école d’été de trois jours, mais enfermés là-bas dans la montagne, avec la guérilla ». Pablo raconte qu’il était effrayé avant de partir. Ces formations avaient lieux dans des campements FARC, en pleine montagne, mais surtout, pendant la guerre.
« Quand on est allés là-bas, j’avais peur que l’on croise l’armée ou qu’on tombe dans un combat ; toutes ces choses remplissent de peur l’âme de quelqu’un. En même temps, ça donne une sensation d’adrénaline et ça te remplit de vie ». Il garde cependant un souvenir positif de l’expérience. « Ces moments m’ont procuré des sensations que je n’oublierai jamais : marcher dans la montagne, en tenue militaire, avec des personnes de toutes les villes de Colombie ».
(Il)légalité
Les milices urbaines de l’ancienne guérilla apportaient un soutien logistique aux combattants qui se rendaient secrètement dans la capitale. L’organisation des réunions et des missions passait par le bouche à oreille. « C’était un travail de service de renseignement, d’intelligence secrète. Tout était maintenu secret. Les réunions ne se faisaient pas avec tous les militants réunis mais juste avec les personnes spécifiques qui étaient nécessaires pour une action ». Une des techniques utilisées pour s’assurer qu’aucune information concernant les missions ne puisse être dévoilée, c’était l’individualisation des rôles. « Chaque fonction était individuelle. Parfois on ne savait pas qui faisait quoi, mis à part ce que l’on devait faire nous-même ». D’après Pablo, les militants des structures urbaines étaient nombreux. Mais comme ces actions étaient illégales et secrètes, il est très difficile de le vérifier. Pendant la guerre – et encore aujourd’hui – revendiquer être de gauche correspondait à assumer d’être associé aux FARC et à l’image du guérillero terroriste.
Chaque fonction était individuelle. Parfois on ne savait pas qui faisait quoi, mis à part ce que l’on devait faire nous-même
« On n’avait aucun besoin de dire aux gens : regarde, je fais partie de ce groupe. Et si on l’avait fait, les gens se seraient effrayés. En plus de cela, on aurait pris le risque de se faire dénoncer. Donc nous gardions tout cela secret. C’est comme une forme de survie. C’est mieux que personne ne sache ce que l’on faisait. »
Aujourd’hui, Pablo est encore prisonnier de ce secret. En tant que fonctionnaire de l’État, il sait qu’il ne peut pas exprimer son soutien au parti de la FARC, maintenant légal. « J’ai toujours fait profil bas. Ce serait difficile pour moi d’en parler ouvertement, parce que cela voudrait dire perdre mon travail et perdre mon moyen de subsistance. » Pour lui, le travail et les idées politiques ne devraient pas s’influencer l’un l’autre. « Mais bon, nous sommes en Colombie », dit-il en rigolant. « Au travail, j’essaie de ne pas parler de ce sujet. Je suis très conscient du fait qu’il ne faut pas mélanger travail et politique. Ceux qui sont au courant sont peu nombreux et sont des amis qui militent ou militaient avec moi pour le parti. »
Sens critique
Maintenant que la guérilla des FARC s’est transformée en parti politique, le rôle de Pablo a changé. Il travaille comme militant dans une comuna (voir note de bas de page). Au sein de sa comuna, différents professionnels se réunissent : compagnons, avocats, militants,… Ensemble, ils proposent des idées au conseil d’administration du parti. « Je suis le secrétaire politique de ma comuna. Mon rêve serait de faire partie du conseil d’administration. Cela m’enchanterait. Mais je me retrouverais sans travail et j’ai besoin d’un travail pour pouvoir manger. » Son rôle n’empêche pourtant pas Pablo de garder un esprit critique face au fonctionnement du jeune parti politique. « Nous sommes en train de nous convertir en petits bureaucrates à l’intérieur du parti. Tout ce qu’on critiquait, nous sommes en train de nous convertir à cela. » Le parti de la FARC voudrait proposer un autre fonctionnement politique aux Colombiens, mais pour atteindre le pouvoir et avoir un impact, il doit aussi jouer avec les mêmes règles que les autres partis. « On doit faire le caméléon. C’est un risque que l’on doit assumer et on ne l’assume pas pour l’instant. C’est un peu comme la transition de l’illégalité à la légalité qui s’est faite à l’encontre des politiques que nous défendions avant. Beaucoup pensent comme moi. » Il critique les pratiques politiques du parti. « Soyons honnêtes, certaines personnes ont leur place parce qu’ils sont les amis, les enfants ou les membres de la famille de quelqu’un de haut placé. On passe à côté de nos idéaux. »
Nous sommes en train de nous convertir en petits bureaucrates à l’intérieur du parti. Tout ce qu’on critiquait, nous sommes en train de nous convertir à cela
Pablo n’est pas le seul à être critique. Des divisions se sont ressenties au sein même du parti, avec notamment une lettre longue de sept pages qui critiquait la direction du parti et son président Timochenko, co-signée par un ancien commandant de la guérilla, Joaquim Gomez, et publiée à l’occasion du deuxième Congrès de la FARC en septembre 2018. Ivan Marquez, ancien combattant et négociateur de paix à La Havane, a lui aussi critiqué l’ex-guérilla, regrettant sa naïveté d’avoir déposé les armes avant l’application complète des accords. De son côté, la principale force politique qui s’oppose à la FARC, le parti du président Ivan Duque, le Centre démocratique, auparavant commandé par l’ancien président Alvaro Uribe, parle d’un parti « sans expérience, ni projet politique clair. »
Pablo est conscient des efforts que l’ex-guérilla doit encore fournir pour se faire accepter par la société colombienne. « Je comprends ceux qui haïssent les FARC. Mon père inclus, parce qu’ils lui ont fait du mal. Je ne peux pas lui demander de pardonner quelque chose qu’il ne peut pas pardonner. » Il espère tout de même que la stigmatisation des anciens combattants cessera.
« Nous sommes des personnes à part entière, il ne faut pas uniquement nous considérer comme des assassins. » Aujourd’hui, il se bat pour le respect des personnes, quel que soit leur penchant politique. « Tant qu’on ne se dérange pas, je pense qu’en politique nous devons tous nous entendre. Ceux qui pensent différemment que moi, ont leur manière de penser et j’ai la mienne, le principal c’est qu’on ne se fasse pas de mal. » Une vision pacifiste pour un militant d’une ancienne guérilla qui faisait la guerre pour ses idéaux. C’est peut-être aussi l’une des raisons qui ont fait qu’il n’a jamais pris les armes.
Pour Pablo, la priorité aujourd’hui est de faire comprendre à la population que la guérilla n’était pas la source de tous les maux de son pays. « Les vrais problèmes en Colombie, ce sont l’inégalité, l’iniquité, le manque d’opportunités… et le plus gros d’entre eux, c’est la corruption. Il y a un problème structurel, plus uniquement dans le gouvernement, mais un problème structurel et social. Le problème ne devrait plus être : tu es un ancien guérillero, tu as tué des gens. » Il continue donc de militer auprès de la FARC dans l’espoir d’un jour apporter en Colombie les changements pour lesquels l’ex-guérilla dit se battre depuis 54 ans.
La comuna est une zone géographique qui sert à l’organisation du parti politique. Cette entité n’est pas comparable aux communes que nous connaissons en Belgique.
Eva Seker est une jeune journaliste belge, diplômée de l’IHECS.
Afrique
Mozambique : l’injustice climatique
PHOTOGRAPHIES DE MARION PÉHÉE
Le 14 mars 2019, le Mozambique fait face au cyclone Idai : d’une intensité sans précédent, celui-ci ravage la ville de Beira. Désormais, le Mozambique doit affronter les violentes conséquences du changement climatique sur les populations locales. Ce reportage donne à voir une ville dévastée par cet épisode cyclonique qui a touché de plein fouet les ressources agricoles et maritimes des habitants.
A chaque coin de rue, les scènes de lendemains de bourrasques sont les mêmes… Maisons détruites, toitures arrachées. Aux bouteilles, papiers, plastiques qui jonchent le sol s’ajoutent désormais palmes, bois et branchages indomptables. Les arbres déracinés se sont pour certains violemment encastrés dans les abris les plus fragiles, laissant alors des tas de tôles et de gravats un peu partout dans la ville. On devine ainsi la violence du cyclone Idai qui a touché entre autre Beira, la deuxième ville du pays, causé la mort de 603 personnes et porté préjudice à environ 1,5 million de personnes.
Pour son maire, Daviz Simango, élu en 2004, ce qui s’est passé est le « pire désastre mondial ». La ville est depuis fréquemment mentionnée comme la première ville détruite par le changement climatique. « Je suis triste de dire que Beira va entrer dans l’histoire comme la première ville entièrement détruite par le changement climatique », a déclaré Graça Machel, la très respectée veuve de Nelson Mandela et de son précédent époux, Samora Machel premier président mozambicain.
Sous une chaleur écrasante, Joana Maria Juga sillonne d’un pas vif les rizières dévastées. Rizicultrice depuis trente quatre ans, cette mère de 7 enfants a perdu un hectare de riz sur les deux qu’elle possédait. Idai a également balayé sa maisonnette de tôle dans laquelle elle vivait la semaine pour travailler. Situé à Ceramica-Ngupa, à quelques kilomètres de Beira, son champ – craquelé, sec et incultivable – illustre bien désormais l’inquiétante image du changement climatique.
Avec une production avoisinant les 7000 kg par an, elle pouvait ainsi, en plus de le vendre, nourrir aisément sa famille nombreuse : « On a de plus en plus de problème liés au climat, difficile de savoir ce qu’il va se passer ensuite,» lance-t-elle en observant ses terres desséchées.
Idai n’est pas le premier cyclone à s’abattre sur le Mozambique, comme le précise Olivier Bousquet, directeur de Recherche du MTES (Ministère de la transition écologique et solidaire) et responsable du programme de recherche Interreg-V « ReNovRisk-Cyclones ».« Les cyclones qui ont récemment touché le Mozambique ne sont pas à proprement parler exceptionnels. Ils le sont en termes d’impact (notamment Idai) mais au cours de ces 20 dernières années, 19 systèmes ont touché directement le pays (11 tempêtes et 8 cyclones).»
En plus de ces épisodes cycloniques, le territoire est régulièrement touché par des sécheresses et des inondations. Dans un pays où plus de 80% de la population dépend de l’agriculture pour vivre et 99% d’entre eux sont de petits exploitants agricoles, ces catastrophes climatiques s’avèrent dramatiques et mettent des millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire. Le 14 mars dernier, ce sont 400 000 hectares de production agricole qui ont été ravagés par le cataclysme.
Selon le rapport du GIEC, les eaux devraient se réchauffer de 1.5 à 2° dans le canal du Mozambique, ce qui devrait engendrer des cyclones beaucoup plus intenses Face à ces prévisions désastreuses, Daviz Simango, chef de file du MDM (Mouvement démocratique Mozambicain) et candidat d’opposition pour les élections présidentielles d’octobre prochain, n’est pas resté inactif. Maire de Beira depuis 15 ans, il a en tête les différentes particularités de sa ville, la principale étant sa position géographique: « En tant que ville vulnérable, nous savions bien que le plus grand danger viendrait de l’eau : de la pluie et de la mer, car nous sommes sous le niveau de la mer. » Aussi enclenche-t-il en 2012 des travaux pour construire un système de drainage ainsi qu’un bassin de rétention d’eau, un chantier financé par la Banque mondiale s’élevant à 120 millions de dollars. Des structures qui ont fait leur preuve, comme le précise fièrement Daviz Simango. « En janvier dernier, lors de la saison des pluies et même récemment, nous n’avons pas été inondés grâce à ce système qui fonctionnait parfaitement. Et durant ces années, nous avons également assuré la protection des côtes et du littoral. » Il compte désormais s’attaquer au problème du vent. Début mai, la Banque mondiale a annoncé le déblocage de 350 millions de dollars pour les reconstructions au Mozambique.
Carlos Serra est le plus connu des militants du pays. Il est également avocat, professeur d’université et directeur national du bureau des affaires juridiques du Ministère des terres, de l’environnement et du développement rural. « Après la phase d’urgence résultant du passage du cyclone Idai, il sera nécessaire de tirer des enseignements qui nous permettront de renforcer la résilience souhaitée face aux futurs phénomènes climatiques extrêmes. Beaucoup de choses doivent être repensées, et cela pourrait être l’occasion historique de corriger les erreurs du passé ». Cet activiste social se distingue publiquement pour ses actions, avec une attention particulière pour les journées de nettoyage à la plage : le mouvement « Let’s do it », connu également sous le nom d’Operation Caco, a été lancé en 2015. « Tout est lié à l’éducation. Si nous n’abordons pas l’éducation avec un regard différent, nous n’aurons pas un pays différent, la durabilité n’en sera jamais la devise. Nous voudrons toujours de l’argent rapide et ne nous inquiétons pas de l’impact social et environnemental négatif. »
De nombreux militants travaillent aussi depuis de longues années sur ces problématiques. A l’image de Mélodie Ounda Meybi, directrice de l’association AMOR (association mozambicaine de recyclage) crée en 2009 et financée par l’Union européenne. Elle organise des formations dans les écoles pour promouvoir et organiser le recyclage. C’est ainsi qu’au cours des dernières années, AMOR a mis en place plus de 30 projets de recyclage, impliquant environ 2000 groupes communautaires et plus de 40 000 enfants à travers des activités manuelles, des sessions plus théoriques ou encore culturelles dans le primaire et le secondaire. « L’idée est de faire prendre consciences aux jeunes qu’ils peuvent influer sur leur environnement. » conclut Mélodie.
Dans son petit bureau, face à la mer dans le centre de Beira, Bezura Maboza, souriante et dynamique, travaille quant à elle dans une association locale: ASATE (Associacao Anjos Terrestres), qui va dans le même sens. « Le pays est plein de ressources mais les gens ne savent pas comment les exploiter ». Elle milite pour la plantation des arbres notamment pour protéger les rivages et n’hésite pas à incriminer la politique environnementale de son pays et lance « Le gouvernement n’agit pas, ils n’ont aucune action, pourtant les ressources ne sont pas inépuisables. »
Depuis quelques années fleurissent au Mozambique des initiatives associatives et militantes écologiques alors que gouvernement reste discret sur ces questions. Depuis 1997 et la création d’une loi environnementale, peu de choses ont été réalisées. En 2015, le ministère de l’environnement fusionne avec celui du développement rural devenant ainsi le ministère des Terres, de l’Environnement et du Développement rural. Pour Carlos Serra, « depuis le dernier mandat, la question du développement rural a été mise en avant à cause de la situation de pauvreté du pays ». « Les défis que cela implique sont devenus une priorité, laissant de côté les questions environnementales », semble-t-il regretter.
Le camp humanitaire « Terra Prometida », non loin de Beira, a vu le jour en 2017 lors d’inondations dévastatrices dans la ville. A présent, ces grandes tentes blanches abritent une cinquantaine de personnes dont Joachim Gabriel Quinze et Zeca Silamo Jacane. Pour ces deux pêcheurs, le scénario catastrophe se répète. Après le passage du cyclone, ils ont perdu leur petite maison dans le centre de la ville ainsi que leur matériel de pêche qui leur permettait de vivre correctement et de nourrir leur famille respective. Ils sont désormais dépendants de l’aide humanitaire pour subvenir à leurs besoins, et incriminent l’exploitation gazière au large du pays. Selon un rapport de l’ONG Les Amis de la terre de mai 2019, ce sont près de 5000 milliards de m3 de gaz qui ont été découverts au large du Mozambique entre 2005 et 2013.
A la tête du plus gros projet d’infrastructure destiné à permettre l’exploitation et l’exportation de ces réserves: Total, suivi de 3 projets en cours de développement – Coral South FLNG, Mozambique LNG et Rovuma LNG qui pourraient permettre au Mozambique de produire 31,48 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) chaque année à partir du 2024, faisant du pays le sixième exportateur de GNL au monde.
Un projet dramatique pour la région et ses habitants que ne cesse de dénoncer Justiça Ambiental (JA!), une ONG mozambicaine fondée en 2004. Daniel Ribeiro, coordinateur technique, le martèle. « Notre capacité à être résilient face au changement climatique passe par des forêts denses, des mangroves, de la végétation, etc. qui agissent comme une barrière de sécurité face aux eaux qui montent, aux crues et grosses tempêtes. Cet écosystème permet de se protéger contre le futur du changement climatique, il agit comme absorbeur naturel. Ce projet aura un impact négatif considérable sur l’environnement local, en détruisant des zones de récifs coralliens vierges, des mangroves et herbiers, y compris une flore et une faune menacées dans l’archipel de Quirimbas, une biosphère classée par l’UNESCO. »
Alors que le Mozambique est un pays faible émetteur de gaz à effet de serre, ne produisant pour l’instant que 0,14% des émissions de gaz carbonique au monde et lorsque que – paradoxalement – Total affiche une politique de dé-carbonisation, ces trois projets risquent de voir considérablement enfler ce pourcentage, spécifiquement à cause des émissions de méthane dégagées par l’extraction de gaz, sans pour autant amener d’améliorations concrètes à la population, puisque, selon le rapport des Amis de la terre, « le gaz sera très largement liquéfié puis exporté vers d’autres pays, principalement vers le marché asiatique. »
Amenuisant un peu plus les ressources intérieures en affaiblissant toujours plus le Mozambique – déjà largement touché par les conséquences du réchauffement climatique – les réponses internationales n’ont pas l’envergure appropriée aux problèmes. alors que des projets économiques et commerciaux fleurissent en dépit du bon sens écologique et humain.
Photographe artistique de formation, Marion Péhée se tourne vers le format du photoreportage à l’occasion d’un voyage en Ukraine. Après un travail de longue haleine de cinq ans dans cette zone de guerre qui donnera lieu à Ukraine / 5 years of war, elle fait le choix de partir en Moldavie, puis s’intéresse au sort des femmes Rohingyas fuyant la persécution en Birmanie.
Sisters
PHOTOGRAPHIES DE MORGANE WIRTZ
Au sud du Niger, Agadez est devenue une ville “escale” pour les migrants. Dans ce reportage, Morgane Wirtz a suivi le quotidien de femmes qui s’adonnent à la prostitution pour financer leur voyage jusqu’en Europe. La photojournaliste y dresse le portrait de femmes livrées à elles-mêmes, contraintes de travailler dans des conditions dangereuses, afin de construire un avenir meilleur.
Morgane Wirtz raconte dans ce reportage la vie de plusieurs femmes prostituées dans la ville d’Agadez, plus importante ville du Niger connue notamment pour être un carrefour migratoire sur la route de l’Europe. La photographe raconte, par son travail, le parcours de quelques-unes de ces femmes contraintes de se livrer à la prostitution.
Omowumi est arrivée il y a trois ans à Agadez, dans le nord du Niger. Cette ville est pour elle une escale sur la route de l’Europe et pourquoi pas, plus tard, du Canada. Pour réaliser son rêve, elle met de l’argent de côté en travaillant en tant que serveuse dans les bars et en accumulant les hommes qui l’entretiennent.
Zeynab s’est retrouvée à la rue à la mort de ses parents. La prostitution est la seule solution qui lui soit apparue pour subvenir à ses besoins. Elle vit avec six autres prostituées nigériennes de son âge. Dans ce repère, elles veillent les unes sur les autres. Zeynab rêve de se marier, de trouver un homme qui prendra soin d’elle.
Isabella* est victime de ces réseaux de traite de femmes dont les ramifications vont du Nigeria jusqu’à Rome, Paris ou Bruxelles. Il y a quelques années, elle a suivi une femme, une « Madam », qui lui a promis de l’emmener en Europe. Mais pour elle, c’est à Agadez que son voyage s’est arrêté. La Madam lui a demandé de rembourser le montant du trajet, plus de 2000 euros. Pendant des mois, Isabella s’est prostituée pour payer sa dette. Depuis qu’elle est libre, elle continue. Elle ne sait pas quoi faire d’autre. Elle a besoin d’argent. Elle voudrait s’installer dans un autre pays ou reprendre ses études.
Ces trois femmes habitent la même ville et vivent du même métier, mais ne se connaissent pas. En les suivant, nous découvrons différentes réalités, différents quartiers et différents visages de la prostitution à Agadez. Leur quotidien est douloureux. Elles travaillent dans des quartiers dangereux et sont souvent exposées à diverses drogues. Mais elles considèrent qu’elles n’ont pas le choix. Dans cette ville aux portes du Sahara, vendre son corps est un moyen de survivre, mais aussi de financer la traversée du désert avant d’atteindre la mer méditerranée et puis l’Europe.
* Le prénom a été modifié
Photographe basée à Agadez au Niger, Morgane Wirtz est diplômée de l’IHECS et de l’ULB à Bruxelles. Le continent africain est son terrain de prédilection puisqu’elle y a effectué plusieurs reportages en collaboration avec des médias tels que Le Point Afrique, l’AFP ou encore Le Soir.
Ce qu’il reste des âmes sauvages
ENTRETIEN ET PHOTOGRAPHIES DE MÉLANIE WENGER
Au moyen d’un double ancrage – au Cameroun et au Zimbabwe -, et par une triple perception – celle du chasseur, du braconnier et du ranger -, “Ce qu’il reste des âmes sauvages” propose une véritable immersion dans la faune et la brousse afin de dévoiler que la conservation du monde sauvage en Afrique n’est pas qu’une simple problématique environnementale mais qu’elle implique des intérêts économiques importants.
Pour réussir un photo-reportage, faut-il savoir en amont ce que l’on veut raconter ? (narration se construit sur le terrain et/ou à l’editing)
Elle se construit à différents moment, même avant d’être sur le terrain avec beaucoup de recherches pour essayer de comprendre la problématique du sujet, trouver un angle et trouver l’histoire que j’ai envie de raconter. Dans ce sens là, la narration commence à ce moment. Ensuite, il y’a un long travail que je conçois soit seule, mais ces derniers temps, soit avec une directrice artistique, afin de déterminer la manière avec laquelle nous allons approcher le sujet. Et pour trouver la façon avec laquelle je vais raconter l’histoire, je pense aux situations dans lesquelles je pourrais me mettre afin d’exprimer visuellement cela. J’ai déjà écrit une narration visuelle avant même d’être sur le terrain. Après cela ne veut pas dire que je vais exactement la reproduire parce que la réalité n’est jamais comme on l’attend, et heureusement. Mais globalement, ça me permet d’avoir une trame pour ne pas arriver à un endroit et faire tout et n’importe quoi.
Concevez-vous votre texte et vos photos comme un ensemble, ou est-ce-que ces dernières se valent à elles seules ?
Je conçois mon histoire comme une narration visuelle, exclusivement. Le texte n’est pas forcément quelque chose que j’écris personnellement. Selon la manière avec laquelle je vais transmettre mon histoire, il y’a un petit texte ou il y’a même le texte de quelqu’un d’autre. Parfois, mon histoire va accompagner ou être accompagnée par une autre histoire écrite qui parle du même sujet. Mon storytelling est exclusivement visuel.
Les photo-journalistes sont parfois confrontés à des situations de grande urgence, dans ces moments, la dimension esthétique compte-t-elle encore ?
La dimension esthétique est plus instinctive que formelle. Elle ne compte pas comme on pourrait l’entendre ; c’est une conjugaison de choses qui se passent dans une situation précise. Dans les moments d’urgence, c’est vraiment une question d’instinct. Si nous voulons parler de l’aspect formel comme le cadrage ou la forme de l’image, on ne va pas le faire en pensant.
Comment trouvez-vous le juste milieu entre la part esthétique et journalistique dans votre travail ?
C’est extrêmement compliqué, ça n’intervient pas au même moment. La dimension esthétique, comme je l’ai dit, elle est instinctive tandis que l’aspect journalistique ressort du travail de recherche, des questionnements, et de la curiosité sur place. Ca peut se corréler très facilement. Il y’a un deuxième élément de réponse à la question : en réalité, quand on va former l’histoire en faisant de l’editing. Parfois, on va séquencer ces deux aspects en gardant des photos qui sont extrêmements fortes mais qui n’ont pas forcément un grand potentiel d’informations et vice versa. Certaines photos vont même offrir une respiration et c’est la corrélation de tous ces types de photos qui font une histoire.
Êtes-vous à l’aise avec tous les sujets que vous documentez ? Comment choisissez-vous les sujets que vous documentez ?
Ma manière de travailler a mué, je ne sais plus si on peut appeler s’appeler ça du photojournalisme. Je suis extrêmement indépendante, ce sont mes histoires que je propose à la presse. C’est des narrations que j’ai envie de faire. On va rarement venir à moi avec une histoire. J’ai fait ce choix de choisir les sujets dont j’ai envie de traiter et que ça n’aille que dans ce sens-là.
Dans cette époque de démocratisation de l’image (rachats d’images à des amateurs, réseaux sociaux…), le rôle du photo-journaliste a-t-il encore la même valeur ?
Je pense qu’il a plus de valeur aujourd’hui. On voit cette démocratisation de l’image parce que celle-ci n’a jamais eu autant d’importance dans la vie des gens. Il y’a énormément d’images qui circulent, c’est un problème pour nous parce que c’est un système économique qui doit changer, il ne fonctionne plus avec ce déferlement d’images à bas prix. Mais je pense que l’image n’a jamais eu autant de valeur. On ne prend pas ce problème dans le bon sens, la vraie valeur est encore très forte, on doit juste lui donner une autre signification et s’adapter à comment ça fonctionne. La vraie solution serait de différencier les types d’images et de faire des histoires de qualités, des histoires longues pour aller en profondeur dans les sujets plutôt que s’adapter à la rapidité des choses et de faire des images que n’importe qui peut faire avec son téléphone portable. Il faut faire l’inverse pour garder une utilité.
Qu’est-ce-qu’un “bon reportage” ou un “bon cliché” ?
C’est une question difficile. Une bonne image c’est celle qui provoque quelque chose à l’intérieur des personnes qui la regarde et qui permet d’invoquer un imaginaire qui leur est propre.
Membre fondatrice du collectif Inland Stories, Mélanie Wenger collabore régulièrement avec National Geographic en tant qu’exploratrice. Elle a déjà travaillé avec des médias internationaux tels que Le Figaro Magazine, Le Vif, VSD ou encore Libération. Véritable globe-trotteuse, elle s’est notamment intéressée aux problématiques migratoires en se rendant en Libye, Malte et la Belgique. En 2020 sera publié “Broke Silence”, un projet qui met en lumière les histoires des victimes de violences sexuelles.
Mondes arabes Proche-Orient
Shebab
PHOTOGRAPHIES DE VIRGINIE NGUYEN HOANG
Depuis le 30 mars 2018, les gazaouis se sont lancés dans un mouvement revendiqué comme étant une “marche du retour” vers leurs territoires tombées sous le contrôle israélien en Cisjordanie. Au côté des shebab, Virginie Ngyuen Hoang nous embarque au plus proche de cette contestation palestinienne, en suivant un groupe de jeunes Palestiniens, les kouchouks, dont la mission principale est de brûler des pneus pour gêner la visibilité des snipers israéliens.
Depuis le 30 mars 2018, jour du début du mouvement de «La Grande Marche du retour», plusieurs jeunes hommes appelés en arabe les «shebabs» séjournent au camp de Malaka, à Shejaiya (à l’est de la bande de Gaza). Là, ils protestent, revendiquant leur droit à retourner sur leurs terres d’origine, en Palestine. Ce mouvement était destiné àse terminer le 15 mai 2018, jour de la commémoration de la Nakba (l’exode palestinien de 1948), mais il est toujours d’actualité. Leur but est de réussir à franchir les barrières qui séparent Gaza et Israël, une étape dans leur rêve de retourner sur leurs terres d’origine.
Pour y parvenir, ils se sont organisés en différents groupes. L’un des groupes se charge d’incendier des pneus pendant les manifestations. D’autres doivent fabriquer des cerfs-volants en y accrochant des vêtements en feu enduits de pétrole, ensuite lancés en direction d’Israël. D’autres encore jettent des pierres vers les soldats israéliens.
Dans cette série, Virginie Nguyen suit un groupe de shebabs appelé «Koshouk» («pneus»). Ils ont pour mission de rassembler et de mettre le feu à des pneus afin de réduire la visibilité des tireurs d’élite israéliens pendant les manifestations et lors des tentatives des manifestants d’atteindre la frontière. Sachant que les soldats israéliens n’hésitent pas à tirer sur toute personne se rapprochant de la barrière, pourquoi risquent-ils leur vie ? A cette question, un des shebabs répond que leur rêve est de sortir de Gaza : «Nous n’avons rien à perdre ici, nous ne trouvons pas de travail, nous mourons lentement à Gaza, nous demandons simplement le respect de nos droits, rien de plus et nous sommes prêts à mourir pour cela. Depuis le début du mouvement, vous n’avez vu aucune division parmi la population, nous sommes unis pour atteindre le même objectif et nous voulons qu’Israël et la communauté internationale nous écoutent une fois pour toute ».
Co-fondatrice du collectif HUMA, Virginie Nguyen Hoang travaille
régulièrement sur les thématiques de déplacement des populations
locales en prêtant particulièrement attention à l’exclusion sociale
qui en résulte. Elle s’est intéressée au conflit israélo-palestinien, en
mettant notamment la lumière sur le quotidien de la population
gazaouie. En 2016, son reportage “Gaza, the aftermath” a reçu le
troisième prix MIFA dans la catégorie photo reportage. Elle a
collaboré avec des magazines internationaux comme The
Washington Post, Wall Street Journal, De Standaard et Le Monde.
Liban, faillite d’un système ?
ENTRETIEN AVEC SOFIA AMARA
Depuis 2019, les rues de Beyrouth n’ont pas désempli. Les quelques milliers de manifestants libanais se sont emparés des rues de la capitale libanaise pour exiger la rupture avec un système politique gangrené par la corruption et le clientélisme. Dans cet entretien, Sofia Amara nous explique pourquoi le pouvoir politique actuel est incapable de relever les futurs problèmes économiques du pays et en quoi la mainmise du Hezbollah sur les arcanes de l’Etat empêche le renouvellement du contrat social entre l’Etat libanais et ses citoyens.
Vous êtes grand reporter basée au Liban depuis 20 ans. Est-ce que les événements survenus depuis octobre vous ont surpris ? Et pourquoi maintenant ?
Je pense que cela a surpris tout le monde. Depuis la fin de la guerre civile au début des années 90, il semblait y avoir une sorte de malédiction qui faisait que le Liban ne parvenait pas à se redresser complètement pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ce pays n’arrive pas à se débarrasser de toutes les influences régionales. Ensuite, parce que le Liban ne s’est pas départi de son confessionnalisme ; les populations sont prises en otage par leur chef de communauté parce que la citoyenneté ne s’organise pas du citoyen vers l’État.
Dans ce contexte le mouvement qui s’est dressé ce 17 octobre est absolument miraculeux. Officiellement il s’est déclenché après l’annonce d’une taxe sur les communications WhatsApp – normalement gratuites – qui a provoqué la colère des Libanais. C’est formidable de voir cette population se dresser comme un seul homme sans craindre cet épouvantail de la guerre civile brandi par les seigneurs de guerre pour conserver leur autorité et leur mainmise sur les communautés. Les gens sont descendus ensemble, toutes confessions confondues, tous sexes confondus et ils ont abandonné leur appartenance politique pour dire d’une seule voix : “Nous ne voulons plus de tout ce système”. C’est la nouvelle génération qui a portée ce message. Peut-être qu’après la guerre civile, il fallait une ou deux générations pour que les Libanais réalisent la richesse de leur multiculturalité et remettent en cause l’autorité de certains seigneurs de guerre qui sont en place depuis 1995. Les Libanais veulent transcender les confessions et les communautés, avoir les mêmes droits. même si leur système de quotas (chaque communauté soit être représentées très strictement selon la constitution, ndlr) c’est très sain. C’est ce qui fait la particularité du Liban dans le monde arabe.
Peut-on considérer que ce mouvement est réellement massif s’inscrit-il dans la suite de ce qu’on a appelé les “printemps arabes”?
Il n’est pas du tout massif parce qu’il faut reconnaître qu’une partie importante des citoyens libanais sont contre ce mouvement. Le Hezbollah a une forte assise populaire qui rejette cette contestation. Le mouvement a été diabolisé par son chef Hassan Nasrallah qui a accusé les manifestants “révolutionnaires” d’être téléguidés par l’étranger. Vous avez également tous les partisans du président de la République, allié du Hezbollah, qui sont contre car les manifestations appellent à changer tout le régime incluant, de fait, le président. Néanmoins, à certains moments, il y a eu des centaines de milliers de libanais dans les rues pour protester contre le système.
Pour ce qui est de la comparaison avec le printemps arabe : le Liban l’a connu en 2005. A l’époque, le Premier ministre Rafik Harriri avait été assassiné. Suite à cela, les Libanais sont descendus dans les rues pour demander le départ des troupes syriennes qui avaient fragilisées le système démocratique libanais. Les Syriens avaient tout pouvoir au Liban : ils avaient nommé le président de la République, et réduit la liberté d’expression. C’était ça le printemps des Libanais. Aujourd’hui, le mouvement ne réclame pas des libertés, mais un changement du contrat social au Liban.
Vu de l’Occident, on ne comprend pas toujours ce qu’est le Hezbollah, un parti, un “Etat dans l’Etat?”, une organisation armée ?
C’est un parti politique qui a son aile militaire. Le Hezbollah a commencé à exister au début des années 80. A l’époque, le Liban était en pleine guerre civile et l’Iran changeait de régime : le Shah était tombé à Téhéran, laissant place à une théocratie. Depuis, l’Iran a eu une politique totalement assumée visant à exporter sa révolution. Cette stratégie s’est illustrée par la création du Hezbollah : un outil de l’Iran au Proche-Orient. Le choix s’est porté sur le Liban parce que ce pays a toujours été un terrain propice pour accueillir la guerre des autres.
A partir du Liban le Hezbollah a été présent en Syrie, en Irak, au Yémen, en Afrique et jusqu’au sud du Maroc avec le Polisario. Pendant l’occupation israélienne au Liban, le Hezbollah a été un mouvement de résistance : à l’époque, il était légitime parce qu’il agissait contre une occupation par les armes sur un territoire souverain. Après cela, il n’a plus eu de raison d’être, même si le Hezbollah a prétexté des menaces pour maintenir et sauvegarder son arsenal. Cela divise les Libanais puisque certains d’entre eux pensent qu’il faut rester prêts en cas d’attaque israélienne alors qu’une autre partie de la société libanaise considère que le Liban n’a plus que faire de combattre Israël. Ajoutons aussi qu’une partie de la population libanaise en veut toujours au Hezbollah d’avoir retourné son arsenal contre sa propre population notamment en 2007/2008, lorsqu’une décision gouvernementale leur avait déplu. Pour cette frange des Libanais, toutes les armes devraient être retournées à l’armée, seule détentrice du droit de décider de la guerre et de la paix, et ce, sous la direction d’un chef d’Etat.
Quand on interroge des Libanais de toutes confessions, un mot revient sans cesse : “corruption”. Le Liban est-il malade de sa corruption et également des inégalités très fortes dans le pays ?
Il y a chez les manifestants une remarquable détermination à en découdre avec un système qui ne fonctionne plus. En tant qu’observatrice, je trouve qu’ils n’expriment pas assez leur volonté d’obtenir des dirigeants que ceux-ci se débarrassent des fantômes du passé et de la guerre. Il y a deux visions totalement différentes du Liban : l’une d’entre elle est complètement archaïque, c’est celle des dirigeants qui pensent qu’il faut des gouvernements d’union nationale. Une solution qui selon moi ne marche pas, parce que si tout le monde est au gouvernement, qui le contrôle ? Qui fait ce travail d’opposition ? Les partis doivent apprendre à être séparés. Pour moi c’est l’union nationale qui a tuée la démocratie et qui a facilitée la corruption. La corruption est aussi liée à la mainmise exercée par le Hezbollah sur la société libanaise et à son emprise sur les ports, les aéroports, etc. Il y a aussi la questions des emplois fictifs partagés avec l’autre tandem chiite libanais, le parti Amal, dont le chef est président du Parlement. Il faut se débarrasser de tout ça et la corruption suivra.
Le tableau libanais est marqué par des perspectives économiques assez noires et des craintes par rapport notamment à la dette du pays. Est-ce une crainte que vous partagez ?
Je ne pense pas que la question se pose réellement dans ces termes. Il est vrai que le Liban a une dette abyssale qui représente 150% de son PIB, mais ce n’est pas ça le problème. A partir du 17 octobre, les banques ont fermé pendant des semaines, cela a inquiété les déposants. Puis, à leur réouverture, ils n’ont permis aux déposants de retirer que 400 dollars par semaine, et aujourd’hui ce n’est que 100 ou 150 dollars. C’est inadmissible du point de vue de l’éthique bancaire. A cela, il faut ajouter l’interdiction de procéder à des virements bancaires et une pénurie grave de devises. Plusieurs chercheurs affirment que l’Etat libanais a emprunté auprès des banques l’argent des déposants et que les sources habituelles d’entrée des devises se sont taries. L’argent des déposants se serait ainsi volatilisé. Aujourd’hui, on dit qu’il faudrait deux ou trois ans pour revenir à la situation économique passée. Il y a un gros risque que les déposants en devises se voient rendre leur dépôt dans la monnaie locale qui risque une importante dévaluation.
Face à cette situation, le nouveau gouvernement ne semble pas avoir de nouvelles recettes…
Aucune. Ce nouveau gouvernement a adopté un budget validé par le gouvernement que la rue a fait tomber. Ce budget a été défini sur la base d’informations et de ressources qui n’existent plus. Cela prouve que ce n’est pas un gouvernement d’experts contrairement à ce qui a été affirmé. Ce nouveau gouvernementl est accusé d’être constitué de personnes qu’on appelle des “porte-tarbouches”, à savoir des conseillers de différents politiciens dont l’Etat ne veut plus. Aujourd’hui je pense que les Libanais n’ont plus le luxe de se poser ces questions. Pour redresser ce pays, il faut pouvoir imposer un gouvernement fait d’experts absolument irréprochables éthiquement et avoir les moyens suffisants pour proposer dès aujourd’hui un plan de réformes qui puisse empêcher au pays de s’effondrer économiquement. Ce plan doit être courageux et crédible pour que les bailleurs de fonds puissent injecter des devises dans l’économie libanaise. A ce jour, on n’en voit pas le début, l’urgence ne semble pas être saisie et les ministres n’ont pas la stature pour présenter un tel plan.
Vous parlez du gouvernement qui fait état d’un budget basé sur des chiffres obsolètes. Une autre ombre plane sur l’économie du Liban, c’est l’aide internationale qui semble se tarir, qu’elle vienne d’occident ou du golfe ?
Il faut comprendre que le Liban est un pays sous perfusion d’aides occidentales, des pays du Golfe et de sa diaspora. En 2008, les banques libanaises se sont même plaintes du surplus de fonds à gérer ; et le pays a fait preuve d’une légèreté, en contradiction avec l’appréhension que l’on observait depuis 30/40 ans. Maintenant, les Occidentaux veulent des preuves que ces aides offertes à l’économie libanaise seront utilisées à bon escient. De plus, la diaspora qui alimentait les banques libanaises à la fin des années 2008 en ramenant son argent, ne le fait plus. Pour finir, les pays du Golfe, dont l’argent venait sans conditions ne veulent plus ni donner leur argent, ni le laisser au Liban. La raison est que Mohamed Ben Salman et les Saoudiens considèrent aujourd’hui que le Liban est définitivement perdu et qu’il fait partie des pays satellites de l’Iran à cause de la politique du Hezbollah. Lors de la dernière réunion des pays donateurs au Quai d’Orsay, l’Arabie Saoudite n’était même pas présente. C’est un signe fort pour dire qu’ils ont abandonné le Liban.
Malgré ce contexte économique, la classe politique n’a pas du tout été réformée. Est-ce qu’on peut imaginer une transformation du paysage par des partis trans-confessionnels qui dépasseraient les clivages du pays?
Ce n’est pas pour aujourd’hui mais ce n’est pas ça le problème pour moi. Aujourd’hui le président de la République est chrétien et c’est pourtant lui qui donne sa couverture au Hezbollah. Qui a imposé ce président chrétien ? C’est le Hezbollah. Le problème transcende déjà les communautés. Le pays est bien plus complexe que cela. Pendant deux ans, il y a eu une vacance du pouvoir parce que le Hezbollah a décidé que ça serait Michel Aoun ou personne. Les Libanais dans la rue ont réussi à se débarrasser du confessionnalisme, tandis que les partis politiques alimentent la corruption par crainte d’une nouvelle guerre.
Autre difficulté majeure, la présence de centaines de milliers de Syriens. Leur présence est-elle une charge pour l’économie libanaise dans ce moment de crise…
Les Syriens sont là depuis 2011/2012 et ils ont été pris en charge ici à la grande satisfaction de la communauté internationale trop heureuse qu’ils restent ici. Le Liban est un pays de quelques millions ayant accueilli plus d’un million de réfugiés, c’est énorme. On ne peut pas les comparer à la Turquie, qui est un pays puissant, riche et solide ou encore la Jordanie qui a maintenue les réfugiés dans des camps. Les Syriens ne bénéficient d’aucun service au Liban ; à vrai dire, les Libanais eux-mêmes n’ont accès qu’à très peu de services de la part des autorités.
Y-at-il un ressentiment au Liban face à cette situation ?
Absolument. Il y a eu un racisme vis-à-vis des Syriens comme il y’en a eu vis-à-vis des Palestiniens. Les Syriens sont considérés comme différents des Libanais ; cette forme de racisme ne peut pas être niée mais il y a aussi beaucoup de Libanais qui se sont mobilisés pour aider les réfugiés.
Et un ressentiment par rapport à l’Occident ?
C’est un discours qui a été tenu par les politiciens tombés suite aux manifestations. Il y a effectivement un ressentiment par rapport à l’Occident pour ne pas avoir aidé et pour avoir donné des leçons de démocratie et de bienveillance vis-à-vis de populations déplacées. On peut le comprendre parce que le Liban n’a pas la capacité de faire face à l’accueil d’un cinquième de sa population, pas pour les raisons xénophobes mais pour des raisons mathématiques.
Grand reporter et spécialiste du Proche-Orient, Sofia Amara est basée à Beyrouth. Elle est réalisatrice de documentaires ; elle s’est notamment intéressée aux répercussions de la montée de l’Etat Islamique en Syrie, et plus généralement dans le monde. Elle a reçu le Grand Prix Jean-Louis Calderon pour son documentaire réalisé en 2011 : Syrie, l’enfer de la répression.
Asie Océanie
Rohingyas in Myanmar
PHOTOGRAPHIES DE VÉRONIQUE DE VIGUERIE
Les Rohingyas constituent une minorité de l’Ouest de la Birmanie, opprimée depuis la fin du XIXème siècle dans ce pays majoritairement bouddhiste. En 1982, une loi institutionnalise cette discrimination qui prive les Rohingyas de la nationalité birmane et de leurs droits de citoyens et crée une situation qui répond à tous les critères de la définition juridique d’une situation d’apartheid. Tout au long du XXème siècle, plusieurs flambées de violence (1948, 1962…) contraignent des milliers de Rohingyas à franchir la frontière du Bangladesh.
En 2016, la situation se tend à nouveau et face aux persécutions, des Rohingyas créent des groupes armés qui organisent des attaques de postes-frontières, déclenchant une première riposte très violente de l’armée birmane qui s’accompagne d’exactions multiples et entraîne la fuite de dizaines de milliers de réfugiés.
En août 2017, de nouvelles attaques de plusieurs postes-frontières birmans par des groupes armés Rohingyas font des dizaines de morts et entraînent de nouvelles opérations de représailles d’une extrême férocité. En un mois, près de 6700 Rohingyas auraient été tués lors de ces opérations. De très nombreux villages sont incendiés sur fond de massacres de masses, de viols et de tortures que l’ONU a qualifiés dans un rapport de « difficilement concevables ». Ce déchaînement de violence entraîne, en seulement quelques jours, la fuite de près de 100 000 personnes vers le Bangladesh, dans de gigantesques campements qui manquent de tout.
A la fin de l’année 2017, ils sont entre 600 000 et un million à avoir franchi la frontière, sans espoir de retour.
Véronique de Viguerie est une photographe française. Une fois son diplôme de Droit en poche, elle part étudier le photojournalisme en Angleterre. Après avoir passé trois ans en Afghanistan, elle commence à réaliser des reportages dans le monde entier : de l’Irak à la Somalie en passant par le Liban, le Cachemire, l’Algérie ou la Syrie. Ses travaux ont été notamment exposés au festival Visa pour l’Image de Paris et Perpignan et au Scoop Festival d’Angers. En 2006, elle a publié son premier livre Afghanistan, Regards Croisés avec Marie Bourreau, puis Carnets de reportages du XXIème siècle en 2011, et en 2015 Profession : Reporter avec Manon Quérouil Bruneel.
Wastepickers
PHOTOGRAPHIES ET ENTRETIEN AVEC LIZA VAN DER STOCK
Les ramasseurs de déchets jouent un rôle essentiel dans des grandes villes comme Mumbai (Bombay). Chaque jour, des milliers d’entre eux parcourent les rues et les décharges pour recycler les déchets créés par d’autres. Ils jouent un rôle auquel l’Etat, par manque de volonté et de moyens, a en grande partie renoncé. Même si leur rôle est essentiel les ramasseurs de déchets sont stigmatisés en Inde et doivent se battre pour l’égalité de leurs droits. Dans cette série, Liza Van der Stock met en lumière des femmes fortes aux histoires incroyables et inspirantes.
Le récit fait-il partie de la création ? Si oui, comment le construire ?
Pour moi, le storytelling visuel est crucial. Je ne peux pas travailler sans ça. Mon travail, ce ne sont pas que de belles photos. L’histoire est importante. Je commence toujours à travailler à partir des histoires des personnes avec qui je collabore. Lorsque je me lance dans un nouveau projet, j’essaie de ne pas avoir une narration préconçue dans ma tête. Autrement, on ne finit que par chercher les éléments qui puissent la construire. Je n’adopte pas cette approche. J’essaie d’être toujours ouverte et réceptive à d’autres aspects auxquels je n’ai pas forcément pensé.
Vos textes et vos images sont-ils construits dans un continuum ? Votre texte est-il une introduction à vos images ou s’agit-il d’entités distinctes (les images peuvent fonctionner seules) ?
Dans mon travail, les deux vont de pair : la plupart de mes textes reprend les paroles des gens présents dans mes photos (extraits d’interviews ou encore des conversations que nous avons eues). Je les utilise pour contextualiser mon travail photographique parce que je pense que c’est plus parlant qu’une simple légende descriptive. Mon introduction permet de cadrer le travail pour qu’un lecteur puisse avoir une idée précise des paramètres de création de mes photos (ex: quand est-ce qu’une photo a été prise, dans quel contexte, etc). Pour donner une perspective plus large, il est évident que le texte est important, mais il n’est pas pour autant nécessaire pour comprendre les émotions et le ressenti du photographe. Personnellement, je veux que mes images puissent être comprises sans le texte.
Les photojournalistes sont souvent pressés ou dans des situations difficiles. L’esthétique des images est-elle encore prédominante dans ces moments-là ?
Je ne me considère pas à proprement parler comme une photojournaliste. Le travail que j’ai fait pour Waste Pickers était une initiative personnelle. Ma collaboration avec cette communauté au fil de mon intérêt pour la thématique du traitement des déchets. J’ai lu des articles sur l’importance de la communauté des ‘waste pickers’, qui n’est pas reconnue socialement pour le travail qu’elle réalise au quotidien. Ce reportage n’était pas une commande, parce que je travaille à mon propre compte.
Je réalise une thèse en photographie, ce qui m’offre la possibilité de choisir mes propres sujets, donc je ne suis jamais pressée. Je préfère travailler de cette façon, en prenant le temps d’entendre les histoires des personnes que je rencontre et de comprendre la situation avant de commencer à photographier. Je peux imaginer la difficulté du travail de photojournaliste lorsqu’on est assigné à un reportage à réaliser en quelques jours. On ne peut que prendre des photos en surface parce qu’on a pas le temps de comprendre les dynamiques qui se jouent. C’est pour cette raison que je suis heureuse d’avoir le luxe de prendre mon temps, et je pense que ça se voit dans mon travail. Ce n’est pas quelque chose qui a été fait à la va-vite, mais un travail réalisé sur le temps long.
Comment trouver un équilibre entre la partie artistique et la partie journalistique dans votre travail ?
Je pense que les deux aspects se complètent, mais qu’ils ne doivent pas s’imposer l’un à l’autre. Comme je l’ai dit précédemment, je ne me considère pas comme une journaliste. Je ne travaille pas avec les communautés pour simplement rapporter une situation donnée. C’est plus une collaboration étroite qui peut prendre des mois, et qui n’est pas uniquement photographique, parce qu’elle peut inclure de la vidéo, des collaborations artistiques, etc. J’essaie d’établir un lien avec les communautés que je côtoie. L’aspect artistique est évidemment crucial, et la balance entre les deux vient assez naturellement. Même si j’ai des plans avant de commencer un nouveau projet, une fois que je suis sur le terrain, je travaille à partir de l’input que je reçois de la communauté. C’est pour cette raison que je pense qu’il est primordial de leur montrer mon travail lorsqu’il est en cours de préparation afin de me donner plus de perspectives. Par exemple, pour l’un de mes projets, j’ai organisé des expositions locales afin de susciter un partage d’opinions.
Comment choisissez-vous les sujets que vous photographier ? Ou pourquoi acceptez-vous ou refusez-vous certaines commandes ?
Je travaille comme indépendante. Cela me permet de choisir mes propres sujets et d’avoir la possibilité de ne pas répondre aux commandes des journaux ou des magazines. J’ai toujours cherché à m’intéresser à des communautés ou des personnes qui vivent en marge de la société, comme les minorités, dont les histoires sont souvent négligées et stigmatisées. Les ‘waste pickers’ sont sévèrement discriminés et ne bénéficient pas du respect qu’ils méritent. La communauté transgenre en Inde est aussi un groupe fortement stigmatisé. Je cherche à collaborer avec des personnes qui ne font pas partie de la société “mainstream”. Pour mes futurs projets, je vais essayer de me focaliser sur les problématiques environnementales. J’ai développé un intérêt particulier pour ces questions depuis Waste Pickers. C’est réellement devenu un sujet crucial et de plus en plus de gens comprennent son importance en adoptant des modes de vie plus responsables. A ce niveau, je pense que je peux jouer un rôle par le biais de mon travail photographique.
A l’heure de la démocratisation des visuels (rachats aux amateurs, réseaux sociaux…), quelle est la place d’un photographe ?
C’est vrai que les choses ont changé. Ce n’est plus au photographe de montrer le monde ou d’éclairer ce qui se passe partout dans le monde. Avec l’avènement des smartphones et des réseaux sociaux, tout le monde est photographe. Mais d’un autre côté, je pense que le photographe a toujours un regard assez spécial parce qu’il y a tout un travail de storytelling et de recherche qu’il opère. On ne peut comparer un photographe et quelqu’un qui prend simplement des photos avec son téléphone, même si certains font d’excellentes photos. Il faut également souligner que le rôle du photographe a totalement changé. On doit se réinventer pour ne pas simplement rapporter un fait, mais aussi donner plus de contexte.
Qu’est-ce qu’une bonne histoire ou un bon cliché ? Quand vous sentez-vous satisfaite ?
Premièrement, je suis satisfaite d’un projet lorsque mes photos racontent une histoire par elles-mêmes, qu’elles transmettent une émotion et qu’elles provoquent un intérêt qui pousse les personnes à lire le texte et à s’intéresser au sujet. L’important est qu’on regarder mon travail et qu’on ressente quelque chose. Deuxièmement, je suis heureuse lorsque les gens avec j’ai collaboré se reconnaissent dans mes photos et qu’ils sentent que j’ai eu un regard particulier sur leur communauté.
Jeune photographe anversoise, Liza Van der Stock est doublement diplômée de Sociologie de l’Université de Gant et de photographie de la Kask School. Elle est une femme d’action, de proximité et de dialogue. Que ce soit auprès des travailleurs sexuels de Tanzanie, des collecteurs de déchets de Mumbai ou d’un couple de réalisateurs de films pornographiques au fin fond de la Flandre, il émane de ses photos une bienveillance douce et la création d’un lien direct entre le spectateur et le sujet. Lauréate du “Freedom of Love” Award en 2014 et troisième place du Sony World Photography Awards en 2015, Liza Van der Stock poursuit actuellement ses études en arts à Anvers.
Les Ouïghours, peuple enfermé ?
ENTRETIEN AVEC VANESSA FRANGVILLE
Les récentes fuites de documents du Parti communiste chinois publiés par le New York Times ont jeté une lumière crue et effrayante sur la situation dans la région Xinjiang. Dans cette région musulmane du nord-ouest de la Chine près d’un million de Ouïghours seraient enfermés dans des « camps de rééducation ». Dans cet entretien, Vanessa Frangville éclaire une politique répressive ancrée dans un projet de surveillance plus global.
Les Ouïghours, peuple musulman de Chine occidentale subissent une répression féroce et à huis-clos. Même si des documents ont filtré à-t-on une idée précise de ce qui se passe dans cette région ?
Pour commencer, il faut comprendre que la région où est concentrée la population Ouïghoure a été occupée par la Chine en 1949. Il y a un lien très fort entre ce territoire composé de plusieurs royaumes et la Chine mais néanmoins la domination territoriale, le contrôle des ressources, qu’elles soient humaines ou naturelles, et la domination administrative sont très récents.
Dans les années 1930-40, il y a eu deux républiques indépendantes appelées le Turkestan oriental. Le terme même de la région qu’on appelle maintenant “Xinjiang” signifie “nouvelle frontière” en chinois. C’est un territoire occupé avec de vraies politiques de colonisation. On y envoie massivement des populations qui viennent des terres intérieures de Chine, qui s’installent et prennent en charge l’extraction des ressources qui sont renvoyées, par la suite, vers les territoires centraux et les côtes. Il est très important de signaler que c’est un peuple qui est occupé sur son territoire.
La population est très surveillée par l’état chinois et en particulier depuis la fin de la révolution culturelle dans années 80. Jusqu’alors les politiques un certain relâchement avait permis aux Ouïghours de produire de la littérature, et de développer des recherches sur leur propre culture. On a même observé quelques mouvements nationalistes Ouïghours qui ont voulu mettre en avant l’histoire de leur peuple, en contradiction avec l’historiographie officielle chinoise qui considère que cette région a toujours appartenu à la Chine. Bien entendu ce n’est pas le cas, puisque ce peuple est turcophones et converti à l’islam, même s’ils ne sont pas tous musulmans et que l’on compte des communautés chrétiennes et athées. Ces populations ont une identité forte et des revendications théoriquement reconnues par la constitution chinoise censée assurer la protection des droits des minorités et de leurs cultures.
Est-ce que c’est aussi la situation “stratégique” de la région qui contribue à la mettre sous la pression de Pékin ?
Le peuple ouïghour est persécuté parce qu’il occupe un territoire important dans la Chine contemporaine. C’est un territoire à la frontière de tous les “stans” – Kazakhstan, Turkménistan, etc. – des pays relativements récents.
Dans cette région de la Chine, vous n’avez pas que des Ouïghours, mais il y a plusieurs autres minorités qui ont obtenu des territoires indépendants à la chute de l’Union soviétique. Par exemple, les Kazakhs ont migré vers le Kazakhstan, il y a eu des transferts de populations mais les Ouïghours n’ont pas eu de “Ouïghourstan”. La crainte chinoise est celle d’une contagion et la perte d’un territoire extrêmement important qui pourrait donner des idées à d’autres. De plus, c’est une territoire tampon par rapport à la Russie ou l’Inde, qui se situe sur des frontières très contestées. Si vous n’avez plus une population qui vous est fidèle et loyale, cela fait courir un risque pour Pékin.
Une région également primordiale sur le plan économique ?
Effectivement c’est une région essentielle pour toutes les nouvelles “routes de la soie” chinoises, dont les trois points de départ se situent dans cette région. Il faut donc maintenir une stabilité dans une région riche en ressources minières, en gaz, en pétrole, etc. Le problème pour Pékin, c’est que la population qui l’occupe n’est pas docile. Les Ouïghours ont de fait de plus en plus de difficultés à accepter l’arrivée massive des Chinois (des Hans) à qui Pekin confie les emplois sur place (parfois mêmes quand les hans ont des diplômes moins importants que les locaux).
Cette montée des tensions sont le fait des politiques menées depuis Pékin qui impose à une population occupée de façon brutale de s’aligner avec le “centre”, à 4.000 kilomètres de là.
La singularité religieuse de la région doit également contribuer aux tensions avec le centre ?
Le fait que les Ouighours soient musulmans est un facteur délibérément mis en avant par la Chine. En effet, dans l’ambiance islamophobe actuelle, cela permet à l’état chinois de justifier sa politique répressive en brandissant l’argument de la lutte contre le terrorisme.
La menace terroriste, fiction ou réalité dans la région ?
L’état chinois a répertorié une centaine d’incidents qui relèveraient du terrorisme organisé par les ouïghours, mais les chercheurs s’accordent à dire qu’il n’y en a eu qu’entre 3 et 10. La Chine joue sur le flou qui entoure le terme de “terrorisme” pour montrer qu’elle aussi est touchée par ce phénomène. Bien qu’il y ait des formes de radicalisme qui ont émergées, elles sont avant tout le résultat de problèmes socioéconomiques. Cette réaffirmation des identités s’exprime chez certains par l’islam, tandis que chez d’autres, elle peut prendre la forme de littérature qui réinvestit la mémoire ouïghoure. Le mouvement de radicalisation est plus facile à traquer car il répond à des tendances internationales.
Y-a-t-il en toile de fond de cette politique un racisme chinois anti-musulman ?
Depuis 2009, nous avons noté une vraie montée d’islamophobie dans les forums chinois. Il y a des stéréotypes très forts qui sont alimentés par les médias, l’éducation, l’ignorance, la peur. C’est difficile de trouver du soutien chez une population qui a subi un lavage de cerveau. Les quelques Hans qui s’expriment à l’inverse du cadre habituel sont eux aussi dans les camps, mis en prison, harcelés par la police… Il faut bien comprendre qu’aujourd’hui, en Chine, contredire une politique quelconque peut conduire en prison. Un ancien détenu des camps de concentration ouïghours, basé actuellement aux Pays-Bas, et qui témoigne régulièrement, pense que 10% des personnes dans les camps sur place ne sont pas Ouïghours. D’autres minorités musulmanes, telles que les Hui, sont considérés comme étant bien intégrées à la société chinoise puisque ce sont des chinois qui se sont convertis à l’islam. Ils sont considérés par les Hans comme étant des musulmans modèles qui pratiquent un “islam patriote”. Ils se fondent dans la masse mais il y a de plus en plus d’attaques à leur égard aussi.
La population chinoise est-elle au courant de ce qui se passe dans la région Ouïghoure ?
A Hong-Kong, il y a une conscience très forte et énormément de démonstrations de solidarité lors des manifestations. Bien entendu, il y a une identification et la peur que la même chose arrive sous d’autres formes à Hong-Kong. Sur le territoire chinois proprement dit c’est bien plus compliqué et il y a énormément de choses à prendre en compte. D’abord, la censure des médias est massive et importante. Les Chinois n’ont pas accès aux réseaux sociaux. Une grande majorité de la population est également pétrie dans le nationalisme depuis l’enfance. De plus ils ne connaissent pas forcément de Ouïghours et ont construit un imaginaire stigmatisant autour de cette population musulmane. La Chine fait face à énormément de problèmes socioéconomiques et politiques, chacun cultive son propre jardin. Les politiques ont créé ces formes de ségrégation entre les gens qui font que la solidarité n’arrive plus à s’établir.
Sait-on exactement ce qui se passe dans les “camps de rééducation” où près de 1 million de ouïghours seraient retenus ?
Il y a peu de témoins qui prennent la parole en public pour parler de ces camps. Même s’ils sont libérés les anciens détenus peinent à parler parce qu’ils sont sujet à diverses menaces de la part des autorités chinoises. Dans certains cas, ces mesures de dissuasion peuvent aller jusqu’à des menaces sur des membres de leur famille. C’est pour cette raison que peu de personnes prennent la parole sur le sujet. La Chine a étendu les menaces au-delà des frontières et étendu son réseau de surveillance des Ouïghours. C’est très difficile de les faire parler parce que nous sommes toujours en analyse de ce qu’ils ont vécu ; en plus des traumatismes vécus, ils ont peur. Nous savons qu’il y a plusieurs sortes de camps, et que le cheminement d’un prisonnier est déterminé par son attitude. Il y a des étapes. La plupart des anciens détenus ont circulé entre plusieurs camps ; on le sait car ils ont changé de tenues, ils ont changé de bâtiments, et parfois de villes. Pour reprendre le témoignage d’un réfugié aux Pays-Bas, il explique que le premier camp est destiné à vous faire tout avouer par l’usage de la torture. Ensuite, en fonction de ce que les autorités ont trouvé sur vous et en fonction de votre collaboration avec eux, soit on vous dirige vers un camp surveillé, soit on vous prépare à une prochaine sortie, en vous apprenant notamment le chinois. Il y a aussi ceux à qui on impose un travail à bas salaire dans des usines qui viennent de s’installer dans la région, c’est une forme de travail forcé. Mais il y a également des gens qui rentrent chez eux mais qui ont tout perdu à savoir leur famille, leur travail, etc. Ils sont lâchés dans la nature mais ils vivent dans des questions misérables. Et puis, certains Ouïghours sortent du système extra-légal des camps pour rentrer dans le système légal : ils sont envoyés en prison. Mais globalement, on a très peu d’informations qui nous parviennent de là-bas. Il faut comprendre que le projet final de la Chine est de créer des citoyens loyaux par la peur pour instaurer une stabilité dans la région.
Quand la répression a-t-elle commencé ? Est-ce la poursuite, à grande échelle d’une politique débutée bien avant ?
En 2016, lorsque des personnes ont commencé à disparaître et qu’il y a eu une perte de contact entre les familles, nous nous sommes posé des questions. Néanmoins, cette politique n’est pas nouvelle ; nous avions déjà constaté que l’état chinois faisait des collectes d’ADN dans certaines régions, qu’on obligeait les gens à avoir des passeports biométriques, etc. L’information demeurait assez parcellaire puisque les gens ne disaient rien. Puis tout d’un coup, ils ont disparu. Dans les différents leaks des médias (notamment ceux du Washington Post), nous comprenons que toute cette politique de répression a été planifiée depuis très longtemps. Elle a été préparée sur tous les plans, et ce, notamment par un travail idéologique sur les cadres du Parti communiste chinois. Nous pouvons également analyser les appels d’offre pour les constructions de camps. Leur mise en place a été très progressive, mais cela fait déjà des années que les chercheurs qui travaillent sur les politiques ethniques perçoivent une radicalisation de l’Etat dans la façon avec laquelle les minorités sont traitées en Chine, et plus particulièrement dans la région ouïghoure.
C’est déjà en 1996 que la Chine a lancé la campagne “Frapper fort” qui visait à lutter contre le terrorisme, le radicalisme et le séparatisme avec des mesures spécifiques : arrestations massives et notamment surveillance à tous les niveaux de l’administration. Cette politique a alterné entre des périodes de relâchement et de resserrement, jusqu’à un incident survenu en 2009 quand des ouvriers ouïghours ont été lynchés par des ouvriers Hans sans que ces derniers ne soient punis. Cela avait alors provoqué de grosses émeutes. Dès lors, on commence à voir dans les pratiques administratives, un resserrement général et une obsession de Pékin sur la région ouïghoure. Les camps sont le point paroxystique de trente ans de politique de surveillance. Cela fait écho au système de crédit social que la Chine est en train de mettre en place, cette politique de surveillance fonctionne à grande échelle comme nous avons pu le constater avec la crise engendrée par le coronavirus. Les gens sont littéralement traqués. Nous pensons que cette région est un laboratoire qui donne à voir ce qui va se passer sur le reste de la Chine dans les années à venir.
La communauté internationale est-elle tétanisée face à la Chine craignant de froisser Pékin si elle manifeste son agacement devant cette situation ?
Dans les organisations internationales, la Chine essaye de redéfinir les lignes et la façon notamment dont sont définis les droits humains et nous la laissons faire. Elle développe également tout un discours qui remet en cause les valeurs occidentales, qui a de l’écho un peu partout dans le monde. Lorsque les ambassadeurs onusiens ont réclamé des éclaircissements quant à la situation dans la région ouïghoure, en réponse cinquante pays dont la plupart sont musulmans (et dont certains ont également des problèmes de terrorisme) ont soutenu la Chine. Pour deux raisons : une partie sont des dictatures qui dépendent économiquement de la Chine.
Pékin a organisé des tours à des hommes politiques, des experts, etc. de différents pays pour visiter ces “camps d’apprentissage” mais ils séparent les occidentaux blancs des musulmans : on ne leur montre pas les mêmes choses, on ne présente pas le même discours. Je pense que l’Union européenne doit se prononcer fermement sur cette question car c’est une bataille de valeurs. Nous devons nous positionner pour défendre le concept de droits humains. Politiquement, nous pouvons agir par des restrictions économiques en fermant nos ports à la Chine, en augmentant les taxes d’exportation, en retirant les entreprises du territoire chinois, etc. A ce niveau il y a des leviers, et ce, contrairement au terrain idéologique où la Chine est en redéfinition constante des normes humaines. Il faut également se défaire de cette idée que la Chine est un partenaire indispensable, et que de ne pas être partenaire avec Pékin c’est laisser la place à d’autres pays concurrents. La conception qui consiste à dire qu’il faut que nous acceptons les règles des Chinois sans imposer les nôtres est erronée.
Vanessa Frangville est directrice du centre de recherche EASt sur l’Asie de l’est à l’ULB spécialiste des politiques ethniques en Chine. Ses travaux académiques s’intéressent aux rapports entre l’ethnicité et la construction de la nation dans la Chine moderne et contemporaine, avec un intérêt particulier sur le cinéma des “minorités ethniques”.
Traverses
Underland
Vivre dans les grottes pendant plus de 500 ans
Andalousie, Espagne
ENTRETIEN ET PHOTOGRAPHIES DE TAMARA MERINO
Cette immersion sous-terre documente le quotidien de la communauté gitane de Guadix, qui vit dans des grottes depuis des décennies, au sud de l’Espagne. En déconstruisant les présupposés, Tamara Merino met la lumière ces lieux d’habitation inédits qui ont abrités pendant des siècles des communautés en marge de la société : Juifs, Musulmans, Gitans… Niché sur la colline de Sacromonte, ce lieu hors du temps préserve les coutumes et traditions des familles troglodytes qui préfèrent la solitude de la “montagne sacrée” aux tumultes de la ville.
Pendant plus d’une centaine d’années, les grottes ont été utilisées par les hommes comme des lieux de logement. La sécurité et l’isolation trouvées dans ces habitats primitifs naturels par les populations préhistoriques ont été,par la suite, recherchées par les cultures modernes, comme dans le Sud de l’Espagne. La construction de grottes en Espagne a commencé lorsque les Arabes ont exporté cette tradition venue des communautés troglodytes d’Afrique du Nord. De nos jours, ces grottes représentent le plus grand tassement en Europe.
Au sud de l’Espagne, la ville de Grenade accueille une communauté troglodyte qui vit dans les grottes de Sacromonte ou “montagne sacrée”. Les grottes ont d’abord permis de faire face aux tempêtes et aux d’animaux sauvages. Après la conquête de Grenade par les rois catholiques et l’expulsion des populations musulmanes et juives, ces résidents et la communauté nomade gitane se sont réfugiés dans ces grottes Elles sont devenues leur lieu d’habitation. Cette zone marginalisée leur a permis de se soustraire au contrôle administratif et à l’ordre ecclésiastique. La majorité des Musulmans, des Juifs et des Gitans qui se sont échappés de Guadix et des villes voisines, ont conçu leurs grottes afin d’assurer leur survie et leur protection. De nos jours, les grottes sont des maisons uniques qui renferment des communautés qui préfèrent à la vie animée et moderne des villes, la paisible solitude des montagnes.
Aujourd’hui, la colline Sacromonte est divisée en deux. La partie la plus haute et sauvage de la colline est un “no-man’s land” habité par des squatteurs qui profitent du vide juridique pour occuper illégalement les lieux. De l’autre côté, la partie inférieure de la colline de Sacromonte abrite essentiellement les Gitans et leurs descendants, en particulier ceux qui ont des racines et des liens familiaux profonds et qui sont venus récupérer leurs maisons ancestrales. Il y a plus de 500 ans, le “flamenco” danse traditionnelle espagnole est née dans les grottes de Sacromonte et jusqu’à aujourd’hui, les familles gitanes préservent avec ferveur leur mode de vie traditionnel.
Guadix et ces villes avoisinantes, également habitées par des communautés troglodytes, ont développé un mode de vie traditionnel où tous les habitant ont la permission d’occuper les grottes dans une ambiance calme entourée par l’impressionnante formation rocheuse de la région. Aujourd’hui, Guadix est considérée comme la capitale européenne des grottes en raison de ces quelques 2.000 maisons souterraines réparties sur une 200 hectares de terres. Elles sont habitées par 4.500 citoyens troglodytes.
Tamara Merino est une photographe basée à Santiago au Chili. Son travail porte une attention particulière aux problématiques socio-culturelles dans leurs rapports aux questions de genre, de race, et de migration. Elle fait partie du collectif Women Photography, qui promeut le travail de femmes photojournalistes du monde entier. Tamara Merino a collaboré avec des médias internationaux tels que The Washington Post, New York Times, et National Geographic.
Océans, comment organiser la mobilisation générale ?
ENTRETIEN AVEC CLAIRE NOUVIAN
Avec son association BLOOM, Claire Nouvian mène une lutte acharnée pour le renforcement du cadre juridique européen afin d’assurer la sauvegarde de l’écosystème aquatique. Elle met la lumière sur l’influence exercée par les lobbies industriels sur les politiques publiques européennes et sur la nécessité de revenir à des méthodes de pêcherie qui s’inscrivent dans la durabilité et qui protègent le modèle social des pêcheurs-artisans.
Vous êtes une ardente défenseur des milieux marins qui sont tout aussi menacés que notre écosystème terrestre. Est-ce que vous pourriez nous évoquer par quelques images les richesses de ces fonds-marins qui sont à l’origine de votre engagement ?
Notre écosystème marin est merveilleux. D’un point de vue spatial nous avons à peine exploré 1% des océans et océans profonds. Mais c’est une course de vitesse contre les industries polluantes et destructrices. Avec l’association BLOOM, nous avons bataillé avec acharnement contre les lobbies de la pêche industrielle dans l’Union Européenne et nous avons eu l’interdiction définitive du chalutage en eaux profondes (au delà de 800 mètres) en 2016. Entre temps, nous avons découvert que l’extraction des minerais en eaux profondes prenait de l’ampleur et que les industries d’extraction commençaient à faire main basse sur les ressources minières des océans profonds.
Ces espaces sont régis par un contexte juridique – soft law – où le laisser-faire prime et où les sanctions sont minimes.
Lorsqu’on observe l’impact de ces actions en eaux profondes, qui peuvent aller jusqu’à 6.000 mètres, on se rend compte qu’il y a des activités qui ont la potentialité de détruire encore plus vastement et rapidement des écosystèmes profonds qui sont extrêmements vulnérables. Nous sommes dans un milieu sidérant de richesse et de beauté mais qui est extrêmement fragilisé par ces changements. Faire passer des machines de guerre est absolument incompatible et irréconciliable avec la fragilité de ces abysses. C’est le même combat que nous avons mené contre la pêche industrielle puisqu’il y a un réel antagonisme entre la puissance technologique et la fragilité biologique. Nous sommes obligés de prendre nos responsabilités par rapport aux extractions qui se produisent souvent dans des eaux internationales. Ces espaces sont régis par un contexte juridique – soft law – où le laisser-faire prime et où les sanctions sont minimes. Au niveau national ou supranational, nous avons un cadre juridique insuffisant. En Europe, nous constatons que les frontières économiques se sont ouvertes tandis que les frontières juridiques connaissent nettement plus de difficultés. Nous sommes dans une course de vitesse entre les industriels, les citoyens, la responsabilité collective, le climat et les juges qui ne peuvent pas agir.
Quelles sont les régions les plus impactées par ces destructions ?
Aucun pays ne dispose d’une liste d’actions magiques qui sont bonnes sur tous les échelons et sur tous les sujets. Le principe de gouvernance européenne, le “gentlemen’s agreement” s’est construit sur un donnant-donnant qui s’illustre de la sorte : “je ne t’embête pas sur les choses que tu fais mal, et vice versa”. Si un Etat fait la leçon à un autre, il peut être certain qu’il y a un retour de manivelle par derrière : c’est le drame de la gouvernance entre Etats membres. C’est pour cette raison que les institutions qui existent sont parfaitement perfectibles et qu’on pourrait imaginer des mesures de contrôle sur le long terme. In fine, si nous envoyons les bons parlementaires au niveau de l’Union Européenne ou national, de bonnes décisions peuvent en ressortir. Au quotidien, nous collaborons avec de très bon élus qui se trouvent être de véritables alliés, mais malheureusement ils ne sont pas majoritaires et ne peuvent pas faire basculer les majorités européennes.
Pour revenir à la question des océans, on décrit souvent une Europe sous influence des lobbies. Est-ce que vous confirmer cela ?
Oui je le confirme. Avec l’association BLOOM, on se bat constamment contre eux. Les lobbies doivent être caractérisés simplement afin que cela reste clair en terme de segmentation intellectuelle : un lobby vient plaider pour un intérêt sectoriel privé. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas le droit de venir faire entendre sa réalité industrielle, économique, entrepreneuriale mais ce qu’il faudrait garantir c’est qu’il n’y ait pas de mensonges et de tentatives de trafic d’influence. C’est sur ce point précis qu’il réside certaines complications parce que nous avons des codes de déontologie parlementaire qui n’appliquent aucune sanction. Nous devons revenir vers une idée de réhabilitation du pouvoir de la sanction parce que les codes de déontologie ne sont rien d’autres que des déclarations d’intention et un habillage de discours. Nous retrouvons des lobbies à tous les échelons de la fusée, notamment au sein de l’Assemblée Nationale française. Dans cette optique, le travail de vigie effectué par l’ONG bruxelloise CEO (Corporate Europe Observatory) est important. Elle rappelle qu’au début de l’Union Européenne, la Commission n’avait pas assez d’employés pour faire face à la charge législative exigée. Ils ont été à l’origine d’une demande de constitution de lobbies extérieurs à la Commission Européenne afin de faire reposer leur expertise sur eux.
Lorsque nous menions campagne contre la pêche en eaux profondes, nous étions 3 femmes à nous battre contre 28 Etats membres, 750 députés, les institutions, et les lobbies industriels.
Là où périssent les services publics, entrent ceux qui ont les moyens de se faire représenter. Pour cette raison, je plaiderais toujours pour un renforcement des services publics qui sont la seule façon d’assurer la représentation de l’intérêt général. Dans tous les secteurs, nous faisons face à ce problème ; lorsque nous menions campagne contre la pêche en eaux profondes, nous étions 3 femmes à nous battre contre 28 Etats membres, 750 députés, les institutions, et les lobbies industriels. Le moment de bascule de la campagne s’est fait avec l’aide des Français, notamment par diffusion de la pétition contre le chalutage en eaux profondes. Grâce aux signatures, nous avons réussi à peser dans le processus démocratique même si nous sommes conscients que ne pouvons pas gagner ce combat avec les pétitions, mais par une série de positions stratégiques et de données scientifiques que nous devons produire avec des moyens ridicules. Ce combat se fait contre des lobbies ayant dépensé des millions d’euros pour influencer en permanence l’ensemble de la chaîne décisionnelle au niveau des Etats membres comme de l’Union. Je tiens à souligner que nous avions remis une pétition en ligne pour interpeller Emmanuel Macron, qui avait fait toutes sortes de promesses par rapport à la pêche électrique, mais qui n’a pas tenu ses éléments de langage. D’autant plus qu’au niveau européen, la France ne se bat absolument pas pour faire interdire la pêche électrique.
Pourquoi la France ne se bat-elle pas contre la pêche électrique. Est-elle également sous l’influence des lobbies ?
Évidemment. La pêche électrique est la réponse technologique lorsque la ressource diminue. En d’autres termes, lorsqu’il y a moins de poissons, la course deviendra de plus en plus tendue entre les acteurs. Celui qui gagnera sera celui qui aura eu la possibilité de les attraper en premier. Cette course effrénée entre les pêcheurs industriels a poussé les pêcheurs néerlandais à faire pression sur la Commission Européenne en 2006 afin de revenir à la pêche électrique, et ce, sous la pression des lobbies industriels. Au lieu de remettre en question leur modèle économique et de revenir à des méthodes de pêche douce pour l’environnement, ils ont eu accès à un nombre de dérogations ahurissantes pour électrocuter la vie marine. Les pêcheurs-artisans qui passent dans le sillon de ces pêcheurs industriels chalutiers, disent que c’est un cimetière, il n’y a plus rien, même les oeufs sont morts. Alors que nous avons des preuves scientifiques de la catastrophe destructrice de ces engins de pêche, les pêcheurs néerlandais ont équipé 84 bateaux chalutiers, alors que légalement ils auraient dû en équiper seulement 14. En 2007, nous avons porté plainte à la Commission Européenne contre le Pays-Bas afin de demander des éclaircissements quant à cette situation ; aucune réponse. Puis, nous nous sommes rendus compte que la Commission Européenne a explicitement menti en ce qui concerne les avis scientifiques donnés pour ouvrir la pêche électrique, et qui disaient ouvertement : Ne donnez pas de dérogation.
Puis, nous nous sommes rendus compte que la Commission Européenne a explicitement menti en ce qui concerne les avis scientifiques donnés pour ouvrir la pêche électrique, et qui disaient ouvertement : Ne donnez pas de dérogation.
Pourtant un cadre illégitime a été créé de toute pièce pour la pêche électrique, qui permet à chaque Etat membre d’équiper 5% des flottes de chalutiers. Qui a profité de cette disposition? Les Pays-Bas sont passés de 5% à 40% en allant chercher d’autres licences. Le fond du problème est institutionnel car la Commission a continué à jouer le jeu en procurant d’autres licences pour la pêche électrique alors que cette pratique ne dispose d’aucun protocole scientifique. Il y a une trilogie toxique entre les Etats, les lobbies industriels constitués et la science d’Etat qui ne joue pas son rôle de gardien du bien commun. Les Pays-Bas ont fait de la fausse pêche scientifique, au delà du cadre réglementaire, subventionnée par l’argent public fourni par les contribuables européens. Lorsque nous avons décidé de mener notre enquête, nous avons eu recours aux données publiques parce qu’elles doivent impérativement être transparentes. Dans ce cadre, nous avons demandé aux Pays-Bas de nous fournir les dossiers relatifs à la conversion des chalutiers électriques vers l’électricité. A notre surprise le dossier n’était pas disponible alors que les Pays-Bas ont pour obligation de nous le fournir. Après nos multiples plaintes à la Commission Européenne et à l’Office de Lutte Anti-Fraude, nous avons fini par nous adresser au Premier ministre néerlandais. Face à nos coups de boutoir, il a fini par nous le fournir. Tout au long de notre campagne, les lobbies de pêche industrielle néerlandaise n’ont cessé de nous accuser de mentir afin de nous décrédibiliser. Nous avons tout de même fini par obtenir gain de cause puisqu’en janvier 2018, il y a eu un vote clair avec une majorité évidente en faveur d’une interdiction totale de la pêche industrielle. Néanmoins, je tiens à souligner qu’aucune sanction n’a été prise à l’encontre de l’argumentaire mensonger des lobbies, ils ont même demandé à ce que notre association BLOOM soit rayée du registre de transparence pour nos pratiques.
Ce cas est réellement passionnant parce qu’il tue notre vie marine tout en mettant à genoux nos pêcheurs-artisans, qui au final ont les meilleures pratiques. L’écologie sans la prise en compte du social, ça ne marche pas. Il faut alors se battre sur deux fronts : contre la destruction de l’environnement marin par des chalutiers qui rejettent 70% du contenu de leurs filets et contre la destruction des emplois des pêcheurs-artisans qui ne rejettent que 6%.
Avec BLOOM, vous préconisez de repasser à la pêche artisanale. Avec tout ce que vous décrivez, est-ce encore possible ?
Ce n’est pas notre seule préconisation. On pense qu’il y a différentes segmentations entre la méthode artisanale douce pour l’environnement et la méthode industrielle avec des bateaux plus grands et qui peuvent aller plus loin qu’un pêcheur artisan. Parfois, les méthodes de pêche industrielle peuvent être acceptables pour l’environnement : toute pêche industrielle n’est pas mauvaise. D’ailleurs en France, nous avons quelques cas de pêches industrielles assez virtueuses avec des conditions sociales très correctes. Ce qu’on redoute et ce qui rend la chose impossible en terme de survie pour les pêcheurs artisans, c’est la compétition avec les pêcheurs industriels. Pourtant, c’est la situation qui prévaut en France : un homme qui a un petit bateau se retrouve face à des outils de pêche qui sont d’une efficacité sidérante. Cette concurrence ne devrait pas être tolérée. Pour cette raison, nous préconisons un usage exclusif par les pêcheurs artisans sur une distance bien déterminée. Plusieurs publications scientifiques stipulent que la pêche artisanale est la meilleure option de durabilité, même si un petit bateau peut faire des dégâts avec un usage exagéré des filets de pêche. Néanmoins, d’un point de vue écologique, humain et économique, il est plus facile de faire de s’inscrire dans la durabilité avec de la petite pêche. Il est primordial que les politiques publiques fassent de la préservation des emplois une priorité sur la pêche comme sur l’agriculture.Les modèles sont comparables car nous laissons tomber nos paysans et nos agriculteurs en ne leur garantissant pas une vie digne. Il y a un réel problème d’efficacité de la dimension industrielle de notre monde et le cas de la pêche est évocateur. Nous sommes sur une ressource doublement publique puisque le poisson n’appartient pas plus au pêcheur qu’à nous, dont le secteur est lourdement subventionné.
Il y a un réel problème d’efficacité de la dimension industrielle de notre monde et le cas de la pêche est évocateur.
Nous avons, à double titre, le droit de nous intéresser à ces affaires. Si la préservation des emplois était une priorité pour les pouvoirs publics, cela ferait tomber automatiquement les pires méthodes de pêche. En effet, lorsque le gouvernement français – parmi tant d’autres – annonce être contre la pêche électrique mais qu’il ne fait pas peser son poids au conseil de l’Union par le biais des diplomates français, c’est qu’il y a des intérêts cachés. Malgré le carnage socio-écologique qui se profile, les industriels français veulent leur part du gâteau. Nous sommes dans une tragédie des communs où celui qui veut avoir accès à la ressource en premier doit être capable d’influencer les politiques publiques pour enlever de son chemin les écueils qui se présentent, à savoir les pêcheurs-artisans et les réglementations.
Vous vous battez contre les mensonges, il se trouve que les labels sont souvent menteurs.
Actuellement lorsqu’un citoyen conscient des menaces qui pèsent sur les pêcheurs et la production décide de faire un achat responsable, il fait face à tellement de logos qu’il est un peu perdu. Pour commencer, il faut savoir bien distinguer entre “logo” et “label” : un label dispose d’un cahier des charges. A titre d’exemple, le label Marine Stewardship Council a le mérite d’être parfaitement transparent, chose fondamentale à nos yeux. En effet, cette transparence du cahier des charges nous permet d’évaluer sa robustesse, ses critères et ses modes d’emploi. Et là nous arrivons à ce que j’appelle la “mafia des labels”, car les labels sont des business de certification : nous nous retrouvons avec des professionnels de la certification qui vont créer des cahiers des charges sur-mesure et privés. Ces mêmes professionnels reviendront voir si vous les appliquer. En résumé, vous créez vos critères, vous ne les diffusez pas sur la place publique et vous payez le même certificateur qui vous a fait le cahier des charges pour s’assurer du respect de ces dits critères. C’est pour cette raison que MSC se distingue puisqu’il présente des critères complexes et publics. Néanmoins, l’application des notations sur certains cas peut poser des problèmes . Par exemple, la pêche électrique a raté la certification MSC de seulement 3% sur un des trois critères. Un label qui permet la labellisation d’une méthode de pêche aussi destructrice pour les écosystèmes et les hommes met la lumière sur un souci au niveau de l’application des cahiers des charges.
Est-ce qu’il y a des régions du monde, hors Europe, où nous avons un usage raisonné de l’environnement aquatique ?
Afin de répondre à cette question, je vais revenir sur la question des labels. MSC a donné son feu vert à de grandes pêcheries chalutières américaines. Du point de vue de la gestion de la ressource mono-spécifique du colin d’Alaska – sans prendre en compte les animaux qui vivent autour ou encore l’impact sur les écosystèmes -, nous pouvons dire qu’il est correctement géré puisque des évaluations scientifiques sont menées afin de fixer des quotas. Clairement, nous nous situons dans un cas de figure où il y a une bonne gestion par rapport à d’autres pêcheries. Néanmoins, celle-ci se fait avec des chalutiers qui dévastent l’écosystème marin et qui ont pourtant été labellisées par MSC comme “pêche durable”. Ce n’est pas ce que nous appelons de la pêche durable. Si vous estimez que passer avec d’énormes chalutiers en permanence sur les fonds marins c’est acceptable alors il y a des pays qui gèrent mieux que d’autres. Mais, si nous estimons que cette méthode n’est pas acceptable, il y a de petites zones comme les Açores ou Madère qui gèrent mieux leurs pêcheries, et ce, en raison de l’interdiction de détruire l’environnement. Si vous me demandez s’il existe un pays ayant mis en place un modèle qui permettrait de préserver l’environnement et un usage durable d’une ressource qui se reproduit tout en ne mettant pas en péril le substrat permettant de protéger les emplois et les finances publiques, de ce point de vue là, il n’y a aucun pays qui ait le feu vert.
Après sa démission fracassante, Nicolas Hulot a expliqué qu’il ne sentait pas un véritable soutien de la société civile à son engagement. Vous avez parlé des signatures de pétition mais est-ce qu’on peut lui donner raison lorsqu’il affirme qu’il n’y a pas un sursaut citoyen.
Je ne sais pas si on évalue avec les bons critères ce qu’on appelle le sursaut citoyen. J’ai plutôt l’impression que le problème se situe à ce niveau : mon sentiment c’est qu’il n’y a rien qui change dans les pratiques, tout va en s’empirant et c’est quantifiable. Les feux qui étaient déjà au rouge sont passés au noir mais la conscience évolue, nous avons changé d’ère. Si nous évaluons le soutien citoyen par le nombre de personnes qui descendent dans la rue, ce n’est pas un bon outil. Au 21ème siècle, il y a des tas de façon de manifester son soutien et son inquiétude par rapport à l’avenir que de descendre dans la rue. D’une certaine façon, j’ai l’impression qu’on est de plus en plus nombreux à vivre dans l’angoisse car les facteurs quantifiés et quantifiables autour de nous sont vraiment alarmants.
D’une certaine façon, j’ai l’impression qu’on est de plus en plus nombreux à vivre dans l’angoisse car les facteurs quantifiés et quantifiables autour de nous sont vraiment alarmants.
Quand on nous dit que nous avons jusqu’à 2030 pour changer nos méthodes de production, de consommation, de déplacement et d’alimentation, qu’on a 12 ans pour produire des changements qu’on a été incapable de produire en tant que collectif, on se dit que cela va être le défi du millénaire. Nous avons été nombreux à faire face à l’appel en 2017 des 15.000 scientifiques qui ont mis en garde l’humanité en criant alerte rouge. Est-ce qu’on a envie de descendre dans la rue tous les quatre matins pour manifester ? Je ne crois pas, cela me paraît surannée comme façon de manifester notre mobilisation. Les outils numériques et les réseaux sociaux nous permettent de le faire différemment. Nous ne sommes pas seuls à être conscients. Face à des politiques publiques qui se font écho d’intérêts privés, nous avons tous envie de nous mettre en avant parce qu’il n’y a pas de fatalité autre que notre inaction.
Malgré la mise en garde des 15.000 scientifiques, cela n’a pas empêché les Américains d’élire Donald Trump. Le cas de figure est similaire pour les Brésiliens qui ont porté Bolsonaro au pouvoir malgré ses propos sur la suppression du ministère de l’Ecologie, alors que ce pays a un vivier en matière d’efforts à faire avec la forêt amazonienne qui est considérable. C’est compliqué de garder la foi…
La confiance dans l’avenir réside dans notre action d’aujourd’hui, si on se met tous à aller dans le bon sens on va y arriver. Mais si nous voulons rester dans notre zone de confort, on n’y arrivera pas. Bien sûr qu’il faut des sacrifices au sens de l’engagement et qu’il faut choisir entre passer sa soirée avec ses copains tranquillement ou participer à un mouvement citoyen. Nous sommes passés à une économie de guerre et quand la guerre est là, la neutralité est criminelle, on doit choisir son camp. Il y a ceux qui pensent que les entreprises et les multinationales vont par une main invisible du marché se réguler parce qu’elles ne sont pas folles et ceux qui pensent qu’il va falloir créer de la contrainte et prendre notre responsabilité collectivement afin d’amener les pouvoirs politiques et économiques dans une voie compatible avec notre sécurité et le maintien de nos libertés.
Nous avons des solutions qui sont opérantes au niveau local. Si nous enlevons le tissu associatif, notre société se délite ; ces solutions qui existent au niveau individuel, local ou régional, il suffit de les faire changer d’échelle.
Penser que la France est à l’abri de la possibilité d’aller vers un pouvoir liberticide serait une illusion grave. En face de Macron, il n’y a pas une force constituée majoritaire capable de nous mettre à l’abri du Front National. Il faut en prendre conscience afin de se mettre en mouvement et se dire que ce n’est plus possible que les lobbies régissent nos politiques publiques. Ce n’est pas en continuant d’aller vers des modèles productivistes dépendant de la pétrochimie, vers des modèles où les paysans meurent de faim, que ça ira mieux. La violence du monde sur tous les sujets est ahurissante, nous avons des solutions qui sont opérantes au niveau local. Si nous enlevons le tissu associatif, notre société se délite ; ces solutions qui existent au niveau individuel, local ou régional, il suffit de les faire changer d’échelle. Nous n’avons jamais eu besoin d’autant de politiques publiques dans nos vies. Malheureusement les élus qui nous défendent ne sont pas du tout majoritaires, c’est pour cette raison qu’il faut reprendre le pouvoir pour qu’il soit citoyen.
Claire Nouvian est directrice de l’association BLOOM pour la protection des écosystèmes marins. Militante écologique acharnée, son engagement s’est illustré sous plusieurs formes : elle a notamment écrit le livre Abysses (2006), qui a été traduit en plusieurs langues et connu un franc succès. Plusieurs de ses documentaires reçoivent des distinctions prestigieuses tels que Expedition dans les abysses, lauréat pour le prix du documentaire d’aventure au Festival Mondial du Film d’Aventure Amazonas au Brésil en 2005.
Our sons will know sea with no fish
“Nos fils connaîtront des mers sans poissons”
PHOTOGRAPHIES D’ADRIENNE SURPRENANT
En Afrique de l’Ouest, les industries chalutières s’adonnent à une surpêche effroyable qui a des conséquences catastrophiques sur l’environnement marin. Les filets de pêche électrique vident la mer des poissons et menacent la pérennité des artisans-pêcheurs africains. Dans ce reportage, Adrienne Surprenant accompagne ces derniers au Cameroun où ils ont migré pour subvenir aux besoins de leurs familles. Cette migration intra-africaine inédite a fini par créer des tensions entre les populations camerounaises locales et ces nouveaux arrivants.
À l’embouchure du fleuve Sanaga et des plages de sable blanc de Yoyo, plus de 3000 pêcheurs d’Afrique de l’Ouest sont venus s’établir dans la municipalité de Mouanko, au Cameroun. Ils forment maintenant un tiers de la population locale dans cette région où 90% des habitants dépendent de la pêche. Ils ont quitté le Ghana, le Nigéria ou le Bénin à cause de la surpêche. Leur exil a été provoqué par une catastrophe causée par l’Homme : l’exploitation à outrance des ressources océaniques par des compagnies étrangères, qui a privé les pêcheurs artisanaux d’Afrique de l’Ouest de leurs moyens de subsistance.
La quantité de poissons sortie des eaux d’Afrique de l’Ouest a triplé depuis les années 70. En 2016, les produits de la mer exportés de cette région atteignaient une valeur de 874 millions d’euros. La même année, près de 300 bateaux chinois pratiquant la pêche industrielle jetaient leurs filets dans la région. La population de mérou a été réduite de 80%. Le Overseas Development Institute publiait la même année un rapport sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), qui affirmait que ces pratiques illégales causaient la perte annuelle de 300 000 emplois en Afrique de l’Ouest. Ce qui a forcé les pêcheurs à migrer à la recherche d’eaux plus fécondes.
J’ai photographié ces marins migrants d’Afrique de l’Ouest à Mouanko, et leur mode de vie menacé. Je les ai suivis vers la mer, au marché aux poissons et dans leurs camps, alors qu’ils travaillent pour survivre, depuis leurs pirogues ou bateaux Awasha, dans l’ombre des navires industriels possédés par des étrangers. J’ai été témoin de leur relation conflictuelle avec les populations locales camerounaises, qui les voient comme des rivaux. Et alors que, incités par la diminution des poissons en mer, ils se glissent entre les racines des mangroves de la Sanaga, j’ai photographié la manière dont ils déstabilisent le déjà fragile environnement côtier du Cameroun.
Cette histoire est celle d’une migration Sud-Sud, et de l’impact de l’Homme sur la nature.
36% de la migration mondiale va d’un pays en développement à un autre. Et ces mouvements de population changent l’environnement et l’économie des pays d’accueil tels que le Cameroun. Dans ce cas-ci, c’est la pêche industrielle et la surexploitation des ressources naturelles qui a conduit un groupe d’individus à migrer vers un écosystème plus productif, mais tout aussi menacé. Comme le dit Eugène Zounon, un pêcheur béninois : “Un jour, nos fils connaîtront des mers sans poissons. La mer se vide.”
Photographe Canadienne, Adrienne Surprenant est aujourd’hui installée à Bnagui en Centre-afrique. Après avoir étudié la photographie commerciale, elle choisit d’adopter une démarche documentaire en s’intéressant à la construction identitaire dans son rapport au territoire habité. Ce spectre de recherche large la conduit à aborder différentes problématiques sociales et environnementales plus concrètes comme la reconstruction des populations après le passage de Boko Haram au Cameroun ou les sécheresses menaçants le mode de vie traditionnel somalien. Dans Our sons will know sea with no fish, elle raconte la complexité d’une migration sud-sud, où la tradition menacée, devient à son tour menaçante.












![[Left] Marilyn Ochoa in the yard where she celebrated her son’s 5th birthday after a year of fighting cancer. In San Cristóbal, close to the Venezuela-Colombia border. [Right] Light enters from a rotten roof in Petare slum, in Caracas, Venezuela. From the series Blurred in Despair.](https://geopolis.brussels/expos-en-ligne/femmes-photojournalistes/wp-content/uploads/2020/07/BlurredInDespair_22-1024x770.jpg)


![[Left] A cemetery in Portuguesa State, Venezuela. [Right] A farmer stands behind a plastic courtain in Portuguesa State, Venezuela. November 2017. From the series Blurred in Despair.](https://geopolis.brussels/expos-en-ligne/femmes-photojournalistes/wp-content/uploads/2020/07/BlurredInDespair_19-1024x770.jpg)




![[Left] A woman stands behind a curtain inside her home in Petare, Caracas. [Right] Hands painted on a wall in Petare, Caracas.](https://geopolis.brussels/expos-en-ligne/femmes-photojournalistes/wp-content/uploads/2020/07/BlurredInDespair_15-1024x770.jpg)

![[Left] A mortuary ornament in a cemetery in the Guajira desert, close to the Venezuela-Colombia border. [Right] the legs of a young goat that was immobilized before being killed. Death is always present in Venezuela, where around 28,000 people were murdered in 2016, according to the Venezuelan Observatory of Violence.](https://geopolis.brussels/expos-en-ligne/femmes-photojournalistes/wp-content/uploads/2020/07/BlurredInDespair_17-1024x770.jpg)